Nous nous sommes longtemps interrogés sur la manière dont la dette, lorsqu’elle devient le carburant du développement, peut aussi se transformer en une chaîne invisible. Deux histoires récentes, l’une en Asie, l’autre en Afrique, offrent matière à réflexion sur ce paradoxe. Deux pays, deux stratégies de développement, mais une même mécanique de dépendance.
Au Sri Lanka, tout commence en 2010, avec l’ambition démesurée d’un petit pays insulaire de transformer le port de Hambantota en un hub stratégique au carrefour des routes maritimes. Le projet est vaste, l’argent fait défaut, et la Chine s’avance avec des promesses de financement. Environ 1,5 milliard de dollars sont mobilisés sous forme de prêts pour donner vie à ce rêve. Mais la réalité s’avère cruelle. Le port reste désespérément vide, les revenus stagnent, et les échéances de remboursement s’accumulent. En 2017, le gouvernement sri-lankais se voit contraint de céder 70 % du port à China Merchants Port Holdings, sous un bail de 99 ans. Officiellement, il s’agissait d’un arrangement commercial. Officieusement, cela résonne comme une perte de souveraineté. Certains y voient la stratégie discrète d’une puissance qui, sous couvert de partenariats économiques, tisse patiemment sa toile d’influence. D’autres évoquent simplement un mauvais calcul économique. Mais le fait demeure, le port sri-lankais, bâti sur de l’argent chinois, appartient désormais en grande partie à la Chine.
De l’autre côté du continent, en Zambie, l’histoire suit une trajectoire différente mais aux résonances similaires. Le pays, riche en ressources minières mais pauvre en infrastructures modernes, lance de vastes projets de développement. Routes, aéroports, barrages, autant d’infrastructures financées par des emprunts massifs, dont environ 3 milliards de dollars prêtés par la Chine. Les infrastructures sortent de terre, les dettes s’accumulent. En 2020, le choc est brutal. La dette publique atteint 140 % du PIB et la Zambie devient le premier pays africain à faire défaut sur ses obligations souveraines pendant la pandémie. Rapidement, des inquiétudes surgissent. Certains craignent que la Chine puisse chercher à récupérer ses investissements en saisissant des actifs stratégiques. Des infrastructures électriques, peut-être, ou encore des compagnies publiques. Le gouvernement zambien dément toute tentative de saisie. Mais les doutes persistent. Quand la dette devient un outil de pression, la souveraineté économique se fragilise.
Et cette souveraineté, certains la voient s’effriter au-delà du seul domaine économique. En 2017, dans une décision qui a soulevé un tollé, le service de police zambien intègre des ressortissants chinois en tant que réservistes (polices de réserve). Officiellement, cette mesure visait à renforcer la communication et la sécurité dans les communautés chinoises locales, parfois ciblée par des attaques criminelles. Mais cette décision n’a pas été interprétée de manière anodine. Dans un contexte où la Zambie accumule des milliards de dettes envers la Chine, cette mesure a été perçue comme le reflet d’une influence grandissante, imposée à travers les relations financières. Car si la Chine ne détenait pas une telle emprise économique sur la Zambie, l’idée même d’intégrer des ressortissants étrangers dans des fonctions sécuritaires (publiques et régaliennes) n’aurait jamais vu le jour. Dans un pays libre de ses dettes, la souveraineté sécuritaire reste une ligne rouge. Mais quand la dette creuse des trous dans l’économie, les lignes rouges deviennent floues, et l’influence étrangère s’infiltre, voire sous l’uniforme national.
Ainsi donc, lorsque la dette devient un levier de pression, elle ne se limite pas aux seuls chiffres. Elle redessine les contours du pouvoir, elle influence les décisions de gouvernance, et elle transforme même les normes d’autorité et de souveraineté. Quand l’économie est liée, la politique et la sécurité ne sont jamais très loin.
Ces deux histoires, racontées à des milliers de kilomètres l’une de l’autre, posent pourtant la même question. Jusqu’où peut-on développer un pays avec l’argent des autres sans céder un morceau de sa souveraineté. Et à quel moment le partenariat se transforme-t-il en dépendance.



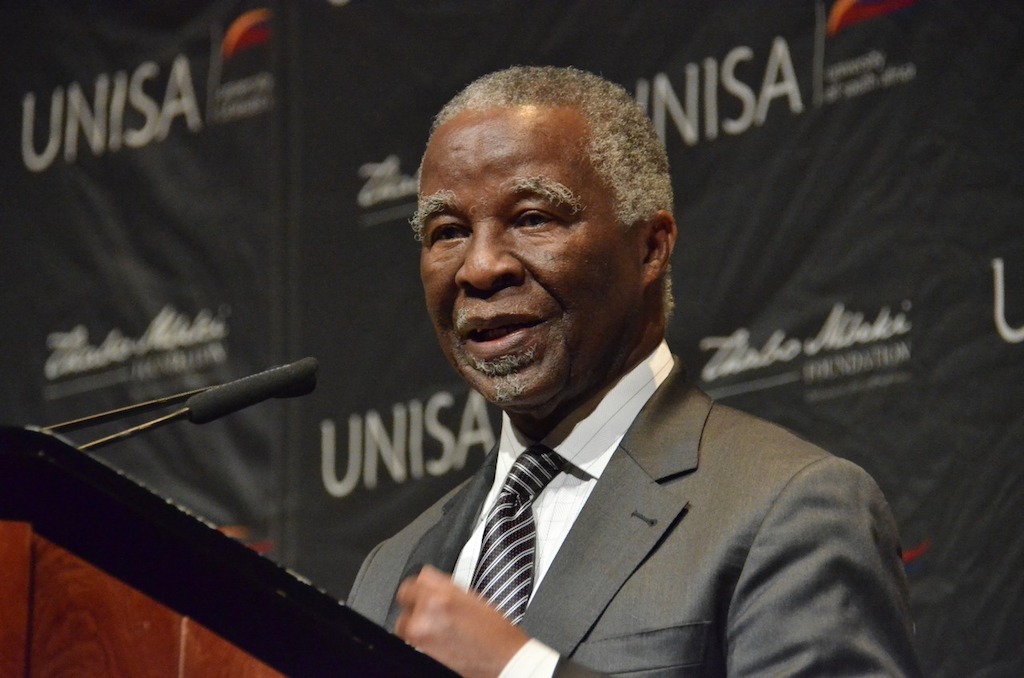

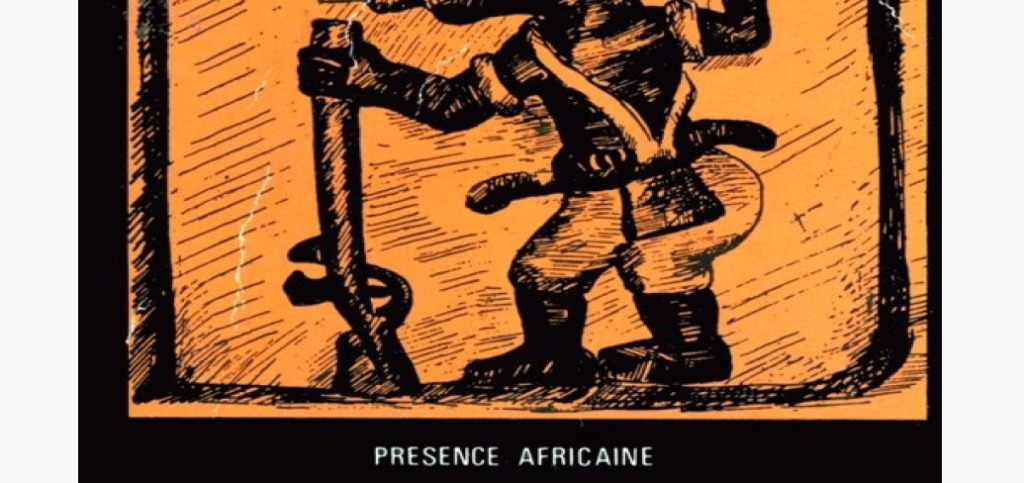
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.