Akodah AYEWOUADAN
Il est une lapalissade que d’affirmer que les difficultés d’une saisie holistique de l’apparence par le droit sont connues. Saisir et tirer des effets de droit de l’apparence est donc l’une des gageures auxquelles le droit pénal est constamment confronté. Celle-ci prend un tour plus complexe lorsqu’il s’agit d’analyser l’apparence dans la constitution de l’infraction en droit burkinabè.
L’infraction, c’est-à-dire tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes apparaît comme un comportement antisocial sanctionné[1], sauf lorsqu’elle est couverte par une cause de justification [2].
L’apparence est une notion polysémique et délicate[3]. Elle n’est pas définie par le droit burkinabè. La doctrine africaine n’est pas très loquace sur la question, la jurisprudence est à l’avenant. Elle supporte sous la plume des auteurs des significations diverses qui sont loin d’en simplifier la compréhension. Pour en tracer les frontières, il n’est d’autre méthode que de la ramener à sa simplicité originelle. L’apparence peut être définie selon le Vocabulaire Juridique comme la manière dont quelque chose apparaît, se manifeste[4] ; la manière dont quelqu’un ou quelque chose se manifeste aux sens ou à l’esprit. Prise dans cette perspective, elle figure une vraisemblance ou une probabilité. Elle peut alors s’illustrer comme un aspect exclusivement superficiel, souvent trompeur, d’une chose, par opposition à sa réalité. Face à l’apparence, l’on serait en présence d’un faux-semblant, d’une façade, d’une ostentation ou d’un simulacre. La sagesse populaire ne dit-elle pas qu’il ne faut pas se fier aux apparences ? En droit l’apparence permet sous certaines conditions de faire prévaloir les faits sur le droit, d’assurer la sécurité des tiers, la rapidité des transactions. Sous ce jour, l’apparence n’est pas toujours synonyme de vérité. Il peut conséquemment paraître hasardeux de construire sur l’apparence. Il y a des apparences qui sont conformes à la réalité qu’elles révèlent. Il y en a qui la dissimulent[5].
L’apparence peut tromper ou révéler. Elle était connue originellement en droit civil[6] et en droit commercial[7] qui ne l’envisageaient autrement que comme trompeuse ou génératrice de droits. La théorie de la simulation en droit des obligations et la théorie de la possession d’état en droit de la famille constituent des situations pertinentes d’apparence qui créent le droit. La jurisprudence européenne n’a pas manqué de convoquer la notion[8]. Le droit organise lui-même une apparence qui est destinée à porter la réalité juridique à la connaissance des tiers et qui permet conséquemment à ces derniers de se dispenser d’investigations approfondies pour établir les droits d’un individu ou d’un autre[9]. Cette fonction est parfaitement remplie par la publicité et le formalisme.
L’on peut donc envisager de prendre en compte l’apparence dans la constitution de l’infraction comme une situation révélatrice, en creux comme en plein, d’indices suffisants pour soupçonner qu’une infraction a été commise, est en train de se commettre ou vient d’être commise, sans que la preuve formelle ne soit déjà établie. Il s’agit de présumer que l’auteur des « faits » de non-justification est l’auteur d’une autre infraction, dont la preuve ne peut être rapportée ab initio, et que l’on réprimera après[10]. La prise en compte de l’apparence dans la constitution de l’infraction permettrait alors aux autorités judiciaires d’engager des mesures d’investigation, telles que l’enquête de flagrance, la garde à vue, la perquisition. La particularité ici est qu’il appartiendrait au présumé infracteur de contribuer à la preuve de son innocence. Il est alors mis en oeuvre une présomption de responsabilité. Elle permet d’assurer l’efficacité de la répression, alors même que des difficultés probatoires se font jour face à la sophistication effrénée des crimes et à mesure où les règles de droit commun de la preuve révèlent au grand jour leurs insuffisances[11]. L’une des illustrations de cette prise en compte de l’apparence dans la constitution de l’infraction se manifeste dans le « délit d’apparence », consacré notamment par le législateur burkinabè à l’article 332-23, alinéa 1er du code pénal en ces termes : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de Francs CFA quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites »[12].
La disposition vise à faciliter la poursuite puisqu’il n’y aurait plus à apporter la preuve de l’infraction principalement à l’origine de l’augmentation exponentielle du train de vie. A la sollicitation de la partie poursuivante, le juge pénal pourrait présumer que certains éléments de richesse ne proviennent pas de sources licites, dès lors qu’il n’a pas été fourni au tribunal la preuve d’un montant suffisant de revenus d’origine licite pour justifier la valeur totale de la richesse attestée.
La logique probatoire serait alors renversée et il reviendrait conséquemment à la personne poursuivie de donner une explication convaincante sur le caractère licite des sommes d’origine douteuse et sur la légalité de l’accroissement de son patrimoine. Le « délit d’apparence » doit être vu comme une infraction de commission qui consiste, notamment pour une personne ayant exercé un emploi public, à être dans l’incapacité de justifier un enrichissement soudain lorsque cela est requis. Il en va différemment quant aux autres mécanismes juridiques axés sur les produits du crime, tels que les infractions de blanchiment d’argent ou les dispositions de confiscation sans condamnation. En droit français, il faut relever la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 qui a créé, à l’article 321-6, alinéa 1er du code pénal français, le délit général de non justification de ressources. Cette infraction consiste, pour un individu, à ne pas pouvoir justifier soit de ressources correspondant à son train de vie, soit de l’origine d’un bien qu’il détient, alors par ailleurs qu’il est en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui, soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et leur procurant un profit direct ou indirect, soit en sont, à l’inverse, les victimes[13].
Si l’apparence en droit pénal a fait l’objet de recherches doctrinales substantielles[14], le délit d’apparence n’a pas eu l’heur de mobiliser de façon significative la doctrine dans les systèmes juridiques africains. Il faut toutefois signaler une récente étude sur le « délit d’apparence en droit pénal burkinabè »[15].
Le délit d’apparence semble renouveler la règle selon laquelle il n’y a pas de responsabilité pénale sans activité matérielle. Cette réalité n’est pas nouvelle. Plusieurs infractions, notamment celles d’omission ne nécessitent pas non plus d’activité matérielle pour engager la responsabilité pénale de leur auteur. L’omission de porter secours par exemple. L’infraction vient alors compléter une panoplie d’infraction existantes. En effet, en l’espèce, la responsabilité paraît engagée avant l’administration de la preuve.
Classiquement et notamment dans l’ancien code pénal français, qui était applicable dans les colonies par exemple, il était déjà admis des présomptions qui facilitaient le travail de l’accusation. Ainsi, l’article 278 du code pénal français disposait que « tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou de plusieurs effets d’une valeur supérieure à 10 F, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de (…) ». Une telle incrimination permettait de punir le mendiant ou le vagabond pour vol sans établir aucune soustraction[16]. Une présomption de culpabilité pesait donc sur la tête de ces derniers. Il est permis de remonter un peu plus loin pour signaler un texte dit Loi des suspects, « qui ordonne l’arrestation des gens suspects »[17]. Au rang de ceux-ci, il fallait compter « ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars [1793], de leurs moyens d’exister ».
La construction du délit d’apparence n’est pas sans rappeler celle de l’enrichissement illicite[18]. La proximité des deux types d’infraction peut jeter le trouble, mais il faut plutôt y lire, une démarche de politique criminelle. En effet, le délit d’apparence s’inscrit dans un mouvement de pénalisation inspiré de la rationalité pénale moderne. Il questionne la réflexion philosophique sur la relation entre l’apparence et la réalité, la présomption d’innocence et la culpabilité, la vérité et le mensonge, autant de questions au cœur même du phénomène pénal. Avec la consécration d’une telle infraction, une évolution se dessine mettant au centre de la politique criminelle, la sauvegarde d’intérêts et de valeurs[19] dépassant l’individu. La volonté du législateur burkinabè semble être de réduire les mailles du filet et de faire le vide autour des délinquants économiques et financiers. Il semble appliquer la théorie de la « broken window »[20] ou le principe de tolérance zéro. Il faut dire que dans certains cas, l’on a déjà rendu « l’égoïsme, à lui seul, répréhensible »[21]. L’apparence en soi n’est pas condamnable dans l’absolu. L’apparence non justifiée par la suite est en revanche condamnable.
Plusieurs construits de l’analyse criminologique peuvent être mis à contribution pour jeter un éclairage nouveau ou complémentaire sur la question du délit d’apparence. Il est pertinent de convoquer le concept de « White collar crime »[22], développé par le sociologue américain Edwin H. Sutherland pour expliquer le délit d’apparence. Si l’éventail des crimes ou délits liés à ce concept est divers (allant de la fausse facturation à l’usage du faux) les éléments communs à ce type de crime restent la dissimulation et la facilitation des actions en raison de la position privilégiée de l’auteur.
Ériger l’apparence comme moteur de l’infraction est un acte législatif empreint d’une certaine gravité. Dans les systèmes économiques innommés où les théories libérales et néolibérales se contextualisent de façon laborieuse, où les opérations sont pour la majeure partie encore réalisées en espèces et quasiment sous le manteau, les déperditions sont importantes et rendent ardue l’intervention du juge pénal. Dans les systèmes politiques où, l’accession à un poste de responsabilité est bien souvent socialement perçue comme l’occasion d’accroitre sans délai son patrimoine, la consécration d’une telle infraction n’est pas négligeable au plan de l’analyse économique du droit et de la protection des biens publics. Il en va ainsi d’autant plus qu’il est quasiment impossible de prouver les actes individuels de criminalité occulte, notamment lorsque les montants versés sont faibles mais continus. L’on perçoit facilement l’utilitarisme social en arrière-plan de l’incrimination.
Les motivations de la consécration du délit d’apparence sont connues et fort louables. Elles sont d’ordre interne et externe. Au plan interne, le législateur burkinabè ne fait pas mystère de ses intentions. Il indique clairement que l’objet de la loi est la prévention et la répression de la corruption[23]. L’introduction par le législateur de cette nouvelle incrimination, vise à tenir compte des évolutions conjoncturelles de la société, liées à l’apparition ou à la modification des comportements repréhensibles des individus. Ces comportements appellent alors, à leur tour, à une adaptation des incriminations sur fond d’affirmation ou de réaffirmation de certaines valeurs éthiques spécifiques telles que l’intégrité, l’honnêteté. Ces exigences sociétales incitent à une évolution de la répression. Au plan externe, la réécriture du droit pénal semble faite sous la dictée des impératifs des nations Unies. La convention des Nations Unies contre la corruption adoptée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 58/4 du 31 octobre 2003 a posé des linéaments à la réforme[24].
C’est dire qu’en arrière-plan se dissimule un véritable enjeu de politique criminelle. Cette volonté d’adaptation mêlant réactions du corps social, nécessités opportunistes conjoncturelles du moment et idéologie aussi louable soit-elle se heurte à des contraintes plus structurelles du droit pénal. La mise en oeuvre d’une telle politique pourrait mettre en péril les droits et libertés fondamentaux et porter atteinte aux droits établis tels que la présomption d’innocence, le droit au silence, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la charge de la preuve. Le délit d’apparence invite à renouveler l’analyse. En édictant le délit d’apparence dans la constitution de l’infraction, le législateur semble construire une politique criminelle[25] offensive contre les prévaricateurs du bien public. Pour autant, une telle politique n’entraîne-elle pas une déformation du cadre processuel ? A priori, l’affirmative pourrait s’imposer. Toutefois, une telle réponse ne saurait triompher sans nuances.
Il est d’intérêt d’étudier l’action du législateur qui parfois élude le débat sur la cohérence de l’édifice législatif pour proposer des évolutions plus symboliques qu’efficaces. Le respect de la légalité criminelle correspond à une nécessité politique dont la source est la démocratie. Dans une certaine mesure, l’on peut retenir que l’application de la théorie de l’apparence à l’esprit réaliste et subjectiviste du droit pénal pourrait ne pas être déterminante face au principe de la légalité[26] qui est une garantie des libertés individuelles du citoyen face à la société. Toutefois, le délit d’apparence telle que consacré par le législateur burkinabè semble proposer un équilibre entre la répression et le respect des droits fondamentaux. Cette réflexion tendra à voir dans, quelle mesure le pénal peut s’accommoder en pratique de l’apparence. Elle tendra également à démontrer comment les droits et libertés fondamentaux pourraient être préservés le cas échéant. La consécration de l’apparence dans la constitution de l’infraction est l’expression d’un choix de politique criminelle (I). Elle entraîne une déformation du cadre processuel (II).
I. Le choix d’une politique criminelle
Les réticences sur la répression pénale des abstentions sont encore assez fortes au regard de la contrainte exercée sur la liberté individuelle. Cependant, dans une démarche de politique criminelle, le législateur se saisit de l’apparence pour accroître la pression répressive sur les délinquants. La nature nécessairement morale de l’obligation de justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites et sanctionnée ne manque pas de susciter l’inquiétude, à une époque libérale qui défend une stricte démarcation de la morale et du droit. L’infraction d’apparence présente les atours d’une incrimination injuste avec une propension non négligeable à l’arbitraire. Les éléments constitutifs de l’infraction sont discutés. Toutefois, à y regarder de près, les critères de l’infraction sont adaptés (A) et les droits fondamentaux sont préservés (B).

A. L’adaptation des critères de l’infraction
La discussion de l’infraction n’occulte pas la réalité de sa qualification. A la lecture de l’article 323-32 du code pénal burkinabè, les éléments constitutifs de l’infraction sont en place. Ainsi, la condition préalable à l’existence de l’infraction, l’élément légal (1) est pris en compte comme moyen et l’élément matériel s’affirme par sa caractérisation délicate (2).
- La prise en compte de l’élément légal comme moyen
L’ambition du droit pénal est de maintenir l’équilibre entre la paix publique et les libertés individuelles à travers la règle « nullum crimen, nulla poena sine lege »[27], seuls constituent des infractions punissables, les actes et comportements prévus et punis par la loi ou par un règlement. Le principe de la légalité ainsi exprimé est enraciné dans la philosophie des lumières[28]. Certains auteurs ont semblé constaté le déclin du principe légaliste[29], d’autres y ont plutôt vu sa transformation[30]. Relativement au délit d’apparence, l’influence des normes internationales a affleuré à travers la convention des Nations Unies contre la corruption de 2004[31]. L’infraction reste la frontière qui sépare l’individu de la société, « le point de rupture de l’équilibre entretenu entre l’homme et la société »[32]. Son étude passe donc nécessairement par son rattachement successif à l’individu qui la commet, puis, à la société qui s’en plaint[33]. Le rattachement à l’individu caractérise la manifestation de l’infraction alors que le rattachement à la société révèle l’incrimination. Il s’agit de ce que Jacques- Henri Robert, caractérisait par « l’infraction du législateur » et « l’infraction du délinquant » autrement dit « l’infraction décrite » et « l’infraction réalisée »[34]. Dans le cas d’espèce, l’incrimination est manifestée par l’article 332-23 du code pénal burkinabè qui dispose : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de Francs CFA quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites ». L’élément légal est ainsi manifesté. Le délit d’apparence s’attaque à quiconque ne peut justifier raisonnablement l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil justifié par voie réglementaire. En clair, quiconque serait dans l’incapacité de justifier un accroissement de son train de vie subira la foudre de la loi. Cette infraction est spécifique non pas dans sa conception mais plutôt dans son traitement. Il suffit que l’apparence soit faite que vos revenus licites sont en deçà de votre train de vie et que vous soyez dans l’incapacité de le justifier pour que l’infraction soit constituée. Le législateur burkinabè ayant gardé le silence sur la qualité de l’infracteur, l’on peut subodorer que toute personne est visée, qu’elle occupe un emploi public ou privé. L’élément de légalité dans l’infraction d’apparence questionne. Peut-on condamner quelqu’un qui, abusé par l’apparence s’est néanmoins abstenu de porter secours à une victime en réalité hors de danger ? A l’évidence la réponse est négative puisque le texte ne vise que le danger réel. C’est la réalité qui est un élément de légalité. Le législateur fait ici de l’apparence une réalité dans la construction d’une fiction juridique. Peut-on condamner quelqu’un qui avorte une femme qui en réalité n’est pas enceinte ? L’affirmative est de mise, puisque le législateur a érigé l’apparence en élément de légalité.
Cependant, peut-on fonder exclusivement l’élément de légalité d’une infraction sur l’apparence ? Pour Philippe Conte, la réponse à cette question est négative. Il affirme ainsi que « … prétendre tenir compte de la simple apparence d’un élément de la légalité en matière pénale (…) c’est par hypothèse violer, semble-t-il, la légalité criminelle, c’est compromettre les libertés individuelles, c’est menacer la démocratie, sauf, à l’évidence, si cette apparence de réalité a été directement visée par le législateur lui-même »[35]. Le bémol apporté par cet auteur emporte notre conviction et permet d’asseoir notre position. L’on peut fonder l’élément de légalité sur l’apparence. Le droit se construit à l’aide d’apparences sur lesquels on se met d’accord[36]. L’apparence suffit ainsi parfois, par nécessité ou par évidence[37]. L’on donne foi à l’apparence ou au titre[38]. L’article 332-23 alinéa 1er du code pénal burkinabè propose une démarche remarquable qui consacre la part belle à l’apparence dans le déclenchement de la poursuite de l’infraction et ce, de façon expresse, sans toutefois l’ériger en infraction. L’apparence ne fait d’ailleurs pas long feu sur le chemin de la poursuite puisqu’avant même qu’on ne demande à la personne poursuivie de justifier ses ressources, le poursuivant devra établir le train de vie supérieur au seuil réglementaire au regard des revenus licites Une fois fait, ce n’est plus une apparence mais une réalité que la personne poursuivie devra justifier.
L’apparence peut alors être érigée en un élément de la légalité en tant que moyen. Elle confine alors à la réalité qui est ici un élément de légalité. Il faut lier l’apparence dans sa capacité à susciter la souplesse du droit pénal au phénomène de l’autonomie du droit pénal[39]. Le choix de l’apparence pour fonder l’incrimination n’est pas fait ex nihilo. Un comportement est incriminé parce qu’il génère une atteinte à un intérêt juridique, ici l’intérêt est économique. La nomenclature des codes pénaux révèle que les incriminations sont présentées comme des comportements en opposition à certaines valeurs défendues par le droit pénal. Le législateur n’est pas libre dans ses choix d’incrimination. En application de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il ne peut incriminer que les comportements ou les abstentions qui sont potentiellement nuisibles pour la société. C’est en contemplation d’une valeur, d’un intérêt juridique à protéger que l’infraction est construite. Cette infraction parait construite en vue de pallier l’atteinte aux intérêts économique et financiers. Certains parlent de l’élément injuste de l’infraction[40]. Face à un intérêt qu’il souhaiterait protéger, le législateur remonterait la chaîne causale des comportements et incriminerait les comportements pouvant lui causer, de manière plus ou moins proche, une atteinte[41]. Le droit pénal a une fonction propre à savoir la défense de la société et la protection des intérêts essentiels de cette dernière. Il régit les rapports entre l’État et les citoyens et assure la protection des libertés individuelles. Il faut en déduire que pour assurer cette fonction le droit pénal doit définir des normes qui lui soient propres, adaptées à ses buts. Aussi doit-il déterminer les valeurs[42] dignes de sa protection et les moyens d’une telle protection[43]. C’est la manifestation du principe de subsidiarité du droit pénal. Son bras armé est la politique pénale qui vient mettre en musique la vision pénale. En érigeant l’apparence comme élément déterminant de l’infraction, le législateur burkinabè retient essentiellement que celle-ci est dérivée d’une action humaine imputable, extériorisation d’une volonté libre et consciente. De ce fait, et au regard des besoins répressifs de la société, il l’incrimine. La caractérisation de l’élément matériel va dans le même sens, même si elle se révèle délicate.
- La caractérisation délicate de l’élément matériel
L’intention de violer la règle est insuffisante pour provoquer l’ire de la loi. Elle n’est punissable en elle-même que si elle s’accompagne d’une réalisation concrète. En substance, c’est la manifestation tangible de cette intention qui constitue l’exécution de l’infraction, sa matérialisation. L’élément matériel est ainsi un élément constitutif de l’infraction. Il s’agit de la partie extériorisée de l’infraction. Il se manifeste par la réalisation concrète des faits incriminés. Le comportement incriminé au titre de l’élément matériel est divers et il peut varier dans sa nature et dans sa durée.
Il faut ajouter que le fait de faire quelque chose constitue un délit plus lourd que le fait d’omettre. Maius delictum est in faciendo quam in omittendo. L’idée qu’un acte est plus condamnable qu’une omission est courante. Cependant, il a été acquis que l’élément matériel d’une infraction peut, plus exceptionnellement, prendre la forme d’une abstention. Il s’agit dans ce cas d’un acte d’omission. Le législateur fait grief ici à l’agent, à l’inverse, de n’avoir pas fait ce que le texte d’incrimination l’obligeait à faire, c’est-à-dire d’avoir violé une obligation de faire comme porter assistance à une personne en péril.
Relativement à la nature du comportement incriminé, l’infraction d’apparence, en ceci qu’elle consiste dans sa matérialisation, à vivre au-delà d’un seuil réglementaire par rapport à ses revenus licites doit être considérée comme une infraction de commission. Le comportement est alors complété par une abstention délictueuse[44] caractérisée par une omission qui ne peut pas être rapportée à une fonction quelconque assumée préalablement par l’auteur. C’est justement le non accomplissement d’un ou plusieurs actes positifs qui consommera l’infraction. Le délit d’infraction d’apparence doit donc être vue comme une infraction de commission, au même titre que l’infraction d’enrichissement illicite qui consiste à s’enrichir de manière appréciable et injustifiée, lors de l’exercice d’un service public Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Bien souvent, le comportement incriminé va consister en un acte unique. Ainsi en vat- il dans le vol, matériellement consommé par la seule soustraction de la chose d’autrui. On parle alors d’infraction simple. L’infraction est instantanée. L’infraction est souvent consommée en un trait de temps. Elle se consomme instantanément.
L’infraction permanente est une infraction instantanée dont les effets se prolongent nécessairement dans le temps sans nécessité d’une intention constamment renouvelée. Son effet est durable. Ces distinctions sont importantes car elles ont une incidence notable, notamment sur l’application de la loi pénale (dans le temps et dans l’espace) et sur le point de départ du délai de prescription de l’action publique[45].
L’objectif visé par le législateur au regard de cette infraction d’omission est double. D’abord, l’infraction incite, par la menace de la sanction pénale, à une diligence constante. Ensuite, elles facilitent le travail de preuve de la partie poursuivante qui peut, dans cette situation, se satisfaire d’une simple carence matérielle qui repose sur la faute d’inobservation de la réglementation. Les atteintes aux droits fondamentaux sont conséquemment proportionnés.
B. Les atteintes proportionnées aux droits fondamentaux
Selon Niklas Luhmann, les droits fondamentaux ne sont pas le fondement de la société, contrairement à ce que l’expression laisse entendre et à la tradition du droit naturel. Il postule plutôt que les droits fondamentaux ont une fonction dans la société moderne, qui « résulte en définitive des problèmes de constitution systémique et de différenciation sociale »[46]. Le législateur semble avoir pris le parti de la fonctionnalisation du droit qui autorise à renouveler la manière d’appréhender et d’utiliser le droit. Il s’agit de s’éloigner d’une vision strictement formelle et normative du droit pour adopter une perspective plus pragmatique et axée sur les résultats. A cette aune, le délit d’apparence qui peut sembler mettre en péril les droits fondamentaux, doit être analysée différemment. Intégré dans une politique criminelle, une telle infraction permet de trouver des justifications à l’atteinte à la présomption d’innocence (1) et au renversement de la charge de la preuve (2).
- La justification de l’atteinte à la présomption d’innocence
La présomption d’innocence est un principe procédural, un principe directeur du procès pénal et un droit subjectif[47]. Elle innerve plusieurs disciplines juridiques notamment, la procédure pénale, le droit des personnes, les droits de l’homme. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies en donne une explication détaillée : « La présomption d’innocence, qui est fondamentale à la protection des droits de l’homme, attribue au procureur la charge de prouver le chef d’accusation, garantit qu’aucune culpabilité ne peut être présumée avant que l’accusation ne soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable, veille à ce que le doute bénéficie à l’accusé, et exige que les personnes accusées d’un acte criminel soient traitées dans le respect de ce principe »[48]. Le principe est consacré par divers instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme à vocation universelle ou régionale, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)[49], la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)[50] le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)[51], la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH)[52], la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)[53], et bien d’autres[54].
Un regard panoramique sur un échantillon de constitutions nationales[55] donne à voir qu’il s’agit d’un principe juridique quasi universel appliqué aussi bien dans les juridictions de common law que romano-germanique. Au plan législatif, en droit burkinabè l’article 11-16 du code pénal dispose : « Toute personne accusée de la commission d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d’une juridiction compétente ». La démarche est similaire en droit français comparé, à l’article 9-1 du code civil[56].
La relativisation du principe de la présomption d’innocence dans le délit d’apparence correspond à un choix philosophique et social. Le type d’objectif que se donne tout État de droit. Il n’est donc pas discuté, du reste depuis l’affaire Salabiaku c/ France et d’autres affaires[57], que des textes de lois peuvent aller à l’encontre du principe de la présomption d’innocence. En revanche, il n’existe pour l’heure de critères unanimes afin d’évaluer dans quelle mesure une exception légale au principe est admissible. Toutefois, dans un contexte voisin, celui de l’enrichissement illicite, il a été proposé des conditions de l’acceptabilité des exceptions/dérogations au principe de la présomption d’innocence dans divers systèmes juridiques[58] qui peuvent servir d’aiguillon en l’espèce afin de garantir que l’arbitraire n’élira pas domicile au sein de cette infraction. Les juridictions ont utilisé une variété d’approches et de tests différents pour évaluer l’acceptabilité d’exceptions légales potentielles[59]. D’abord, une évaluation de la charge principale qui consiste à vérifier si la partie accusatrice est toujours tenue de prouver les faits principaux de son accusation. Ensuite, une évaluation du lien rationnel, qui permet de vérifier si les faits démontrés par la partie poursuivante dans le cadre d’une procédure prévue par la loi prouvent rationnellement le fait présumé. Après, une évaluation de l’intérêt général pour vérifier si l’atteinte imposée par la loi au principe de la présomption d’innocence y est conforme. Enfin, l’évaluation des connaissances particulières qui permet de vérifier si les faits qui doivent être prouvés pour renverser la présomption qui en découle sont spécialement connus de l’accusé.
Concernant l’évaluation de la charge principale, les juridictions évaluent si le ministère public ou l’État conserve la responsabilité principale de prouver la culpabilité de la personne poursuivie pendant la procédure en vertu de la loi, malgré l’existence d’un mécanisme de renversement de la charge de la preuve[60]. Si le tribunal est convaincu que le ministère public est toujours tenu d’établir les « éléments essentiels » ou les « faits fondamentaux » de l’accusation réelle avant que de tels mécanismes ne soient déclenchés, cela sera considéré comme une justification majeure pour affirmer que la loi particulière est une dérogation acceptable au principe de la présomption d’innocence[61]. Dans l’hypothèse du délit d’apparence, la question qui se pose est de savoir si en cas de refus de la part de la personne poursuivie de fournir les informations sollicitées, l’autorité de poursuite reste tenue de prouver l’existence de l’infraction. Naturellement, il nous semble que celle-ci ne devrait pas rester inactive en cas de silence de la personne poursuivie. Le ministère public conserve la responsabilité de prouver les éléments essentiels de l’infraction. Relativement à l’évaluation du lien rationnel, des juridictions ont également utilisé une évaluation du « lien rationnel » pour déterminer si certaines présomptions légales constituent des dérogations acceptables par rapport au principe de la présomption d’innocence[62]. La démarche postule qu’une présomption légale ne peut pas être validée, s’il n’existe pas de lien rationnel entre le fait prouvé et le fait ultime présumé. Pour Andrew Dornbiere « cette évaluation exige d’une cour qu’elle détermine si le fait présumé, qui entraîne le renversement de la charge de la preuve (par exemple, le fait que le patrimoine d’une personne ne vienne pas d’une source légitime), est une conclusion rationnelle pouvant être faite à partir de faits déjà établis (par exemple, le fait que la valeur de ce patrimoine soit disproportionnée par rapport aux revenus versés à une personne à partir d’une source légitime) »[63]. Dans l’affaire Leary c/ États-Unis cette approche a été renforcée[64]. Pour le délit d’apparence, l’instauration d’un seuil au plan réglementaire devrait aider à clarifier ce point.
Quant à l’évaluation de l’intérêt général, l’un des éléments les plus importants pris en compte par les tribunaux pour déterminer la légitimité des dérogations au principe de la présomption d’innocence est sans doute de savoir si la dérogation sert ou non à protéger un intérêt sociétal plus large. Le débat a largement porté sur la difficulté de trouver l’équilibre entre deux impératifs du système juridique à savoir : la prise en compte de « l’importance de l’enjeu » et « le maintien des droits de la défense »[65]. La violation du principe de la présomption d’innocence par le renversement de la charge de la preuve doit être motivée par un intérêt sociétal supérieur à la protection normalement garantie à chacun par la présomption d’innocence. Au regard de l’ambition du législateur Burkinabè, l’on peut raisonnablement supputer que la recherche de la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption constituent des éléments importants pour l’intérêt général justifiant la dérogation au principe de la présomption d’innocence. A titre de comparaison relativement aux lois sur l’enrichissement illicite – et spécifiquement celles qui visent les agents publics – les tribunaux ont examiné si les charges inverses contenues dans ces lois étaient justifiées par un intérêt public à lutter contre la corruption. C’est l’exemple de l’affaire Attorney général contre Hui Kin-hong[66] où il a été retenu que « Si le droit n’accordait sa protection qu’aux personnes accusées de corruption, mais ne protégeait pas les citoyens ordinaires des démons et des périls de la corruption, il les priverait alors d’une protection égale ». En ce qui concerne, l’évaluation des connaissances spécifiques, elle postule que les renversements de la charge de la preuve sont admissibles si la charge de la preuve pesant sur la personne poursuivie porte sur des éléments spécifiques dont il a personnellement connaissance. Il va sans dire que l’obligation de justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites qui pèse sur la personne poursuivie concerne des éléments dont il a normalement la maîtrise. L’on doit être en capacité de justifier l’origine des éléments composant son patrimoine. Ainsi en droit comparé, dans l’affaire R c/ Johnstone, la Chambre des Lords du Royaume-Uni a analysé la « mesure dans laquelle la charge de la preuve pesant sur l’accusé portait sur des faits » qu’« il peut facilement prouver, car il en a personnellement connaissance, ou auxquels il a facilement accès » dans son évaluation d’un renversement de la charge de la preuve prévu par la loi britannique sur les marques de fabrique (Trade Marks Act) »[67]. La même analyse a été retenue dans l’affaire R c/ Oakes dans laquelle la cour suprême canadienne a relevé la difficulté de justifier une présomption qui met à la charge de la personne poursuivie un fait « par rapport auquel on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’il apporte des preuves, car il n’en a pas personnellement connaissance ou car ce fait va au-delà des éléments à l’égard desquels on pourrait raisonnablement s’attendre qu’il dispose de connaissances… »[68]. Ces différents tests pratiques permettent de justifier la remise en cause de la présomption d’innocence et garantir contre l’arbitraire éventuel. Une justification peut également être proposée quant au renversement de la charge de la preuve.
- La justification du renversement de la charge de la preuve
Le délit d’apparence postule a priori l’hypothèse d’un renversement de la charge de la preuve. Cependant, un autre point de vue est possible. L’on peut retenir que la charge de la preuve n’est jamais renversée et qu’il n’y a donc pas de violation des droits.
L’exégèse de l’article 323-32 du code pénal burkinabè peut conduire à une analyse qui retient sa compatibilité avec le principe de la présomption d’innocence et le renversement de la charge de la preuve. L’hypothèse ici serait que la loi n’inverse jamais réellement la charge de la preuve. Il n’y aurait alors qu’un sous-entendu. Si la personne poursuivie ne peut justifier l’augmentation de ses revenus ou qu’elle observe le silence, cela n’empêche pas le ministère public dans sa position de prouver l’origine frauduleuse ou illicite des revenus querellés. Le procureur doit alors s’évertuer à prouver que l’augmentation du train de vie, qui n’est pas une infraction en soi, est en revanche tirée d’activités illégales voire illicites. Au demeurant, la preuve attendue de la part de la personne poursuivie ne vient que justifier, pour l’exonérer de toute responsabilité pénale, son train de vie apparent supérieur au seuil réglementaire que le Procureur est tenu au préalable de prouver. C’est au Procureur d’établir l’élément matériel de l’infraction.
Il faut évidemment se rappeler que le ministère public n’a pas comme rôle unique d’obtenir la condamnation du prévenu comme une partie civile peut rechercher exclusivement la satisfaction de ses intérêts. Il a la responsabilité d’établir, avant toute chose, la vérité et ne peut, pour ce faire, se poser en adversaire absolu de la personne poursuivie. Au surplus, il est doté de facilités que ce dernier ne possède pas pour parvenir à établir les faits (c’est d’ailleurs une des raisons qui pousseront la victime à joindre son action civile, à l’action publique)[69].
En demandant à la personne poursuivie d’apporter la preuve négative, l’on peut subodorer que l’idée n’est pas de l’accabler à tout prix, mais plutôt de contribuer à la manifestation de la vérité. L’acceptabilité du renversement de la charge de la preuve peut par ailleurs être tirée de ce que l’on considère qu’une personne ayant des revenus légaux n’a aucune difficulté à prouver l’origine légale de ses actifs, car les preuves requises pour que le défendeur s’acquitte de cette charge sont facilement accessibles[70]. Il est difficile de concevoir des scénarios par lesquels un individu avait des quantités importantes de richesse inexpliquée sans aucun moyen de rendre compte de leur accumulation légitime. N’est-il pas plus facile pour une personne d’établir et documenter que son patrimoine est légalement acquis que pour l’État d’établir le contraire ?
De ce fait, la formulation « quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites » ne signifierait pas absolument qu’une personne poursuivie doive tenter de prouver la légalité de l’acquisition du bien. Il s’agit pour lui de justifier pour être exonéré de toute responsabilité pénale. Ad impossibilia nemo tenetur, à l’impossible nul n’est tenu, dit-on. Il appartient plutôt au ministère public de prouver par des moyens de preuve, l’impossibilité de la légalité d’un tel accroissement du train de vie.
Le simple fait que, dans le cadre de l’application de l’article 332-23 du code pénal burkinabè le ministère public doive prouver des circonstances quelque peu différentes de la normale, rien ne permet d’affirmer que le principe de la présomption d’innocence est violé. Dans la plupart des cas, le ministère public doit prouver que les faits ou les actions ont eu lieu, alors que pour prouver l’augmentation du train de vie au-delà du seuil réglementaire, il doit prouver l’impossibilité pour la personne poursuivie d’avoir un tel train de vie au regard de ses revenus actuels, ou prouver l’illicéité des revenus ayant concourus à l’accroissement du train de vie.
La formulation de l’infraction à l’aide d’une déclaration négative (« quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites ») crée inévitablement une situation où l’augmentation du train de vie est indéterminée ou non corrélée au revenu officiellement perçu. Elle met également en lumière l’incapacité de la personne poursuivie à fournir une explication crédible quant à la suffisance de ses revenus perçus officiellement lui permettant d’augmenter son train de vie. Dès lors, le renversement de la charge allégué n’est que virtuel. Le ministère public doit d’abord apporter la preuve de ce que le train de vie a augmenté déraisonnablement au regard du seuil réglementaire. Le droit à la présomption d’innocence n’est pas violé, car il n’appartient pas à la personne poursuivie de prouver la licéité des biens en question. Au lieu de cela, il appartient in fine au Procureur de prouver l’impossibilité de la légalité du bien. Le principe de la présomption d’innocence reste intact, tant que l’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire et que la preuve de sa culpabilité est toujours entre les mains du ministère public. Celui-ci, au moment de la demande, doit déjà disposer des éléments de l’accusation qui démontre l’existence d’un enrichissement illégal qui n’est pas justifié prima facie par les revenus légitimes de l’agent.
Une autre lecture de la charge de la preuve peut être retenue. Cette charge de la preuve peut être considérée comme une charge de preuve dynamique exigeant que celui qui est le mieux à même de prouver le fait soit celui qui le prouve. En pratique, l’on se retrouverait dans une situation où et le ministère public et la personne poursuivie sont en charge de prouver cette situation. L’on s’inscrit dans une démarche que d’aucuns pourraient considérer comme « solidariste »[71] des rapports sociaux.
Cette approche révèle l’hétéronomie du délit d’apparence. La caractérisation de l’infraction d’apparence n’est in fine qu’un début de preuve pour établir la réalité d’autres infractions classiques. L’autorité de poursuite ne peut raisonnablement clore les poursuites du seul fait de l’établissement du délit d’apparence. Mieux, l’établissement du délit d’apparence sans l’adjonction d’autres infractions pourrait être perçu comme une justice en demi-teinte et justifier ainsi la nébuleuse qui l’entoure. Cependant, à y voir de près, le sentiment persiste que la consécration de l’infraction d’apparence remet en cause les principes directeurs du procès pénal.
II. La remise en cause des principes directeurs du procès pénal
La consécration du délit d’apparence illustre le principe d’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe s’oppose à toute extension contra legem du texte d’incrimination. Des incriminations existaient mais, elles étaient insuffisantes pour couvrir ou réprimer la situation en cause. L’inexistence de texte spécifique a donc justifié la prise de position du législateur. A l’analyse, l’on peut relever que le texte érige l’apparence contre les libertés individuelles. Il entraîne une déformation du cadre processuel (A) et atteint les droits de la défense (B).
A. La déformation du cadre processuel
Contextuellement, la consécration du délit d’apparence marque la montée en puissance de la dissuasion prônée par les utilitaristes comme Jeremy Bentham[72]. Un tel modèle s’épanouit dans le système anglosaxon notamment celui américain et bouscule les fondamentaux pénaux des ordres juridiques d’inspiration romano-germanique. Il se caractérise par une utilisation fébrile de l’outil pénal face à la moindre difficulté ou dans le souci d’anticiper toujours plus la prévention des infractions. Ce faisant, le modèle peut s’exposer à la méconnaissance de certaines exigences supra-législatives, singulièrement les droits et libertés fondamentaux encadrant la répression. Le délit d’apparence en ceci qu’il mobilise une présomption de responsabilité entraîne une admission implicite de la présomption de culpabilité (1) et un renversement apparent de la charge de la preuve (2).
- L’admission implicite de la présomption de culpabilité
Le principe de la présomption d’innocence[73] s’entend, dans une formulation théorique pure, de ce que toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement irrévocable[74]. La personne au profit de laquelle la présomption est établie est dispensée d’établir son innocence. C’est à l’accusation de prouver sa culpabilité. La doctrine abonde dans le même sens. Beccaria indiquait que « la justice doit respecter le droit que chacun a d’être cru innocent »[75]. Montesquieu renchérissait en ces termes : « quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus »[76]. Il s’agit d’un postulat de la raison pratique au sens où Kant l’entendait[77]. La présomption d’innocence peut être considérée comme une garantie de l’égalité et de la liberté des citoyens. Cependant, en édictant une sanction contre « …quiconque ne peut raisonnablement justifier l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites… », le législateur burkinabè n’a-t-il pas fragilisé la digue que constitue la présomption d’innocence. Le délit d’apparence dans sa formulation paraît relativiser ainsi le principe de la présomption d’innocence et susciter l’interrogation. Le délit d’apparence est-il une exception légitime au principe de la présomption d’innocence ?
Le principe de la présomption d’innocence n’est pas absolu. Il existe des limites légales tirées du droit pénal substantiel et du droit pénal processuel. Il existe également des situations exceptionnelles dans lesquelles il est possible, de manière compatible avec les droits de l’homme, de justifier un tempérament de la présomption d’innocence dans un sens défavorable à la personne faisant l’objet de soupçons. L’on parle alors de présomption de culpabilité, de présomption de responsabilité. Ces présomptions qui sont loin d’être ignorées en droit positif visent à simplifier l’établissement de la preuve de la culpabilité. En consacrant implicitement une présomption de culpabilité dans le cas du délit d’apparence, le législateur burkinabè a restreint la garantie fournie par le principe de la présomption d’innocence, énoncé dans la constitution burkinabè et autorisé le transfert des obligations du ministère public (de l’État) à la défense (la personne poursuivie). Pour Jacques Buisson « ces présomptions de culpabilité ou de responsabilité ont pour effet, en droit comme en fait, de mettre à la charge de la personne poursuivie la preuve de son innocence alors que la partie poursuivante ne dispose pas toujours des moyens pour le faire »[78].
Ces présomptions de culpabilité allant à rebours du principe de la présomption d’innocence demeurent exceptionnelles et doivent avoir pour source la loi ou la jurisprudence. En droit français, Le Conseil constitutionnel français, dans une décision du 16 juin 1999 a admis que des présomptions de culpabilité puissent être établies, à titre exceptionnel « dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité »[79]. Ce qui a fait dire à un auteur que le Conseil constitutionnel fait de la présomption d’innocence « davantage un impératif de contradiction qu’une condition de prévention »[80].
L’admission implicite de la présomption de culpabilité trouve un fondement philosophique dans le questionnement de sa compatibilité avec la recherche de la vérité. En effet, l’on peut se demander si elle est compatible avec la recherche de la vérité, si elle respecte la dignité des victimes ou si elle est fondée sur des arguments rationnels ou moraux.
Ce point de vue est conforme à la jurisprudence plus large sur cette question (en dehors d’un contexte d’enrichissement illicite), qui a établi que des limites peuvent être imposées au principe de la présomption d’innocence dans certaines circonstances. Ainsi en droit comparé de l’Union européenne, la décision de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Salabiaku contre France[81] reste un précédent clé sur ce point. Dans cette affaire, la cour a examiné une disposition du code des douanes français qui présume qu’une personne en possession d’une valise importée est légalement responsable de son contenu non déclaré. La Cour a procédé à une évaluation pour vérifier si la présomption contenue dans la disposition en jeu était incompatible avec le principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH. Pour déterminer si la présomption légale était compatible, la cour a estimé que le principe de la présomption d’innocence n’est pas un droit absolu et ne devrait pas être considéré comme empêchant les systèmes juridiques nationaux de mettre en œuvre une législation contenant des présomptions réfragables de fait ou de droit, à condition que ces présomptions soient dans des « limites raisonnables » et « préservent les droits de la défense »[82]. L’acceptabilité de cette dérogation au principe de la présomption d’innocence peut être questionnée. Cette dérogation comporte des limites qu’il faudra tracer et identifier.
On peut pousser l’analyse plus loin en considérant la justification des ressources comme un fait justificatif prévu par le législateur au profit de la personne poursuivie. Ou encore un fait justificatif simplement rappelé, de façon surabondante. Le législateur burkinabè pourrait omettre d’indiquer cette justification en formulant l’article comme suit : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de Francs CFA quiconque dont le train de vie a augmenté au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites », que l’incrimination aurait la même portée. Celui qui sera poursuivi dans ces conditions et qui arrivera à justifier ses ressources sera tout autant dégagé de sa responsabilité même si le législateur n’a pas expressément prévu la justification. Au total, si la présomption de culpabilité introduite par la loi est dans l’intérêt public, elle doit être validée. Elle entraîne en tout état de cause un renversement apparent de la charge de la preuve.
2. Le renversement apparent de la charge de la preuve
Dans un procès, la charge de la preuve repose en principe sur le demandeur, c’està- dire celui qui intente l’action en justice : Actori incumbit probatio. Le point est classique en droit. Le demandeur doit apporter des éléments de preuve pour soutenir sa prétention, pour étayer son point de vue. Le défendeur, quant à lui, doit contester les arguments du demandeur. Au surplus, la charge de la preuve en droit pénal est intimement liée au principe fondamental de la présomption d’innocence en vertu duquel tout individu soupçonné d’être coupable d’un délit ou d’un crime doit être réputé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été démontré et reconnue. Il s’agit d’une véritable présomption légale qui fait peser l’entier fardeau de la preuve sur la partie poursuivante. Cependant, dans certains cas, la charge de la preuve peut être inversée, par exemple lorsque le défendeur invoque une cause d’exonération ou lorsque la présomption d’innocence est écartée. Renverser la charge ou le fardeau de la preuve signifie qu’un ou plusieurs participants d’un débat heuristique avance un fait en incombant la charge de la preuve de son contraire à son interlocuteur, ce qui peut être plus difficile ou impossible. L’article 332-23, alinéa 1er du code pénal burkinabè, en édictant le délit d’apparence infléchit la charge de la preuve. Le libellé de la disposition peut donner lieu à une présomption que certains éléments de richesse ont été obtenus de sources illégales, et renverser la charge de la preuve sur l’accusé, l’obligeant à produire des preuves, selon une certaine norme, qui établisse les sources non criminelles de sa richesse. L’inversion de la charge de la preuve crée donc une situation où la responsabilité de prouver ou de réfuter une affirmation est transférée de celui qui la conteste à celui qui l’a fait. Cela peut avoir des conséquences importantes sur le déroulement d’un procès. Il peut en résulter une modification de l’issue du procès en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. Le renversement de la charge de la preuve peut être considéré comme une forme de biais cognitif ou de sophisme. Bertrand Russell a abordé le sujet dans son analogie de la théière qui est une illustration du rasoir d’Ockham[83]. En substance, « ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve »[84]. La formule régulièrement utilisée au cours du XIXe siècle est notamment reprise par le philosophe Christopher Hitchens dans son livre Dieu n’est pas grand[85] et prend la forme du Rasoir d’Hitchens. Le parallèle avec l’argumentum ad ignorantiam, ou appel à l’ignorance, par lequel il est opéré un renversement de la charge de la preuve par celui sur qui repose la charge de la preuve peut être fait ici. Il s’agit de tenir pour vrai ce qui n’est pas prouvé être faux. Le délit d’apparence exige d’une personne poursuivie qu’elle fournisse des explications satisfaisantes quant à la source de sa richesse. Au-delà du caractère simple de la présomption et la préservation des droits de la défense, l’élément décisif en l’espèce est sans doute la vraisemblance de la présomption. Le renversement de la charge de la preuve est subordonné à une exigence préalable, liée aux conditions de réalisation de l’infraction. Il s’agit du défaut de justification des ressources. Un tel renversement de la charge de la preuve qui peut paraître injustifié n’est en rien une innovation dans le droit pénal, qui connaît déjà d’autres cas d’incriminations dont l’un des éléments constitutifs est l’incapacité, pour certaines personnes se trouvant dans des situations précises définies par la loi, à prouver l’origine licite de biens ou de revenus[86]. La démarche du législateur trouve une explication. Il ne s’agit pas d’incriminer, à titre autonome, une non-justification ; il ne s’agit pas non plus, d’assimiler la situation à du recel ou du vol. Il s’agit de mettre à la charge du suspect la preuve de l’augmentation de son train de vie au-delà d’un seuil fixé par voie réglementaire au regard de ses revenus licites. Il ne s’agit donc pas cette fois-ci d’une règle de fond, mais bel et bien d’une disposition de forme, une règle probatoire. Cependant comme le fait très justement remarquée Aïssata Dabo l’on assiste à un renversement réversible de la charge de la preuve. En effet, pour l’auteur, « l’inversion de la charge de la preuve est marquée par une certaine instabilité. S’il est donné à la personne soupçonnée de produire des preuves, même réfutables, il se produit aussitôt un retournement de situation à son profit. Le cas échéant, il incombe à l’accusation de démontrer la non-authenticité des preuves fournies, ipso facto leur caractère inadmissible en justice. Cette circonstance, en fin de compte, fait supporter la charge de la preuve de la preuve à la partie à l’initiative de la poursuite »[87]. De même, jusqu’à ce que la personne dont le train de vie apparent a fondé la poursuite manque de justifier l’origine de ses ressources, elle est présumée innocente. Au demeurant, il appartient au Procureur, le poursuivant de prouver au préalable le train de vie dépassant le seuil réglementaire. Si ce dernier échouait à rapporter cette preuve, le sort de l’accusation peut déjà être scellé ce stade. L’on n’aurait plus besoin que la personne poursuivie justifie ses ressources. Relativement au délit d’apparence le renversement de la charge de la preuve, ajoute au particularisme de ladite infraction. Mais, mieux encore, l’édiction de l’infraction révèle une atteinte aux droits fondamentaux notamment de la défense.
B. L’atteinte aux droits de la défense
Le particularisme des infractions à caractère économique et financier et la difficulté probatoire qu’elles induisent justifie que des mesures exorbitantes du droit commun soient mises en œuvre. Il en va ainsi dans la mesure où ces infractions s’inscrivent dans le cadre politique et économique d’un État qui inclut la sauvegarde de l’équilibre financier des comptes publics. Le délit d’apparence dans sa manifestation semble porter une atteinte franche aux droits de la défense dans une approche négative et dans une approche positive. Il est classique que le droit au silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination soient considérés comme identiques et être traités ensemble. Dans le cadre de cette étude, ils seront abordés séparément. Ainsi, le droit au silence est bâillonné (1) et le droit de ne pas s’incriminer soi-même est édulcoré (2).
- Le droit au silence bâillonné
La parole est un attribut cardinal de la liberté des individus. Pouvoir exprimer librement une pensée est un droit fondamental et est intimement lié à l’ambition démocratique[88]. Mais ne dit-on pas que le silence est d’or, la parole d’argent ? La recherche de la vérité dans le procès civil impose aux parties une communication spontanée et complète de leurs éléments de preuve, pouvant aller jusqu’à une collaboration forcée. Cette approche ne se retrouve pas en procédure pénale. En effet, en matière pénale, aucune disposition n’impose sa collaboration à l’auteur d’une infraction. La personne poursuivie n’a pas à collaborer avec le ministère public, car il bénéficie justement de la présomption d’innocence. C’est qu’ici domine avant tout le principe sacré de la présomption d’innocence qui exclut toute collaboration avec l’accusation. La personne poursuivie a donc un droit au silence.
Ainsi, toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit de garder le silence, de ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Ce droit est essentiel pour protéger les personnes contre les abus de pouvoir, les erreurs judiciaires et les atteintes à leur dignité et à leur réputation. En effet, si l’on est maître de ses mots avant de les dire, l’on en devient esclave après les avoir prononcés. Celui qui a le droit de parler devrait avoir à plus forte raison le droit de se taire. Le droit au silence est un principe élémentaire de la procédure pénale, il a été qualifié par la cour suprême américaine d’unité de mesure du degré de civilisation d’une société donnée[89]. Ce droit est protégé par plusieurs textes internationaux[90]. Il fait partie intégrante du droit à un procès équitable et du droit à la défense[91]. La Cour européenne des droits de l’homme en a souvent rappelée l’importance[92].
Le droit au silence peut paraître être un frein à la procédure pénale, dans la mesure où il révèle la tension entre l’objectif premier d’une enquête policière qui est la manifestation de la vérité et la garantie des droits individuels des personnes accusées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. En réalité, le droit au silence permet de conserver l’équilibre de la procédure pénale en maintenant de façon constante les pouvoirs de coercition destinés à la manifestation de la vérité et la protection des droits des individus.
Le droit au silence est une faculté reconnue à une personne poursuivie. Il s’agit donc d’un droit-liberté (right of silence). La personne poursuivie peut l’activer comme y renoncer. Elle a donc une certaine autonomie et la possibilité d’agir sans contrainte. Le droit au silence apparaît aussi comme un droit-créance[93] (right to silence) impliquant une obligation pour la personne assujettie à son observation. La personne assujettie peut donc exiger la reconnaissance de ce droit ou l’opposer.
Cependant, dans la caractérisation du délit d’apparence, le renversement apparent de la charge de la preuve contenu dans l’article 332-23, alinéa 1er du code pénal burkinabè, semble imposer à la personne poursuivie de parler. Peut-on réellement forcer un mis en cause à parler ? Cela semble discutable. Le juge appréciera le silence par une déduction. Le silence étant perçu comme une entorse à l’office de la justice. Il est permis de penser que dans la crainte de voir se matérialiser l’infraction, le mis en cause peut se retrouver contraint à la parole en violation de son droit au silence.
Le droit au silence n’étant pas absolu[94], il peut être limité dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque la personne concernée est tenue par une obligation légale de parler ou lorsque le refus de parler peut mettre en danger la vie d’autrui, la violation peut être justifiée. Dans l’hypothèse du délit d’apparence une obligation de révélation, de justification de l’accroissement de son patrimoine semble peser sur l’accusé. Au cas où l’autorité de poursuite ne parviendrait pas à prouver que le fonctionnaire, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre, avait, à un moment quelconque de la durée de ses fonctions, été en possession de ressources pécuniaires ou de biens disproportionnés par rapport à ses sources de revenus connues, il se doit de communiquer les informations requises de sa part par l’autorité poursuivante et collaborer ainsi à la manifestation de la vérité, valeur cardinale de notre société. L’idée de la collaboration active ou forcée a partie liée avec le développement du contentieux répressif économique[95]. Dans l’hypothèse où il choisit de garder le silence, le risque est élevé que son implication automatique dans l’infraction en question soit retenue.
Par exemple, dans l’affaire John Murray c/ Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme qui a examiné si le fait pour l’accusé de ne pas répondre aux questions de la police ou de témoigner devant le tribunal pouvait donner lieu à des déductions défavorables à son encontre au cours de la procédure a retenu que « le droit de garder le silence lors d’un interrogatoire de police et le privilège de ne pas s’incriminer sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procédure équitable »[96], et retenu que ces principes ne sont pas absolus. Il peut donc être exigé de la personne poursuivie de ne pas se taire.
Relativiser le droit de se taire, c’est sans doute évoquer la loyauté comme un comportement ou une qualité humaine que l’on exige aujourd’hui dans toutes les relations juridiques, lors de la conclusion d’un contrat comme de son exécution, ou encore à l’occasion de l’exécution d’une charge publique, d’un procès, qu’il soit civil ou répressif[97]. Pour Anne Leborgne, le principe de loyauté n’est certes pas exprimé dans un texte, mais s’il en va ainsi, c’est sans doute qu’il est vu comme un principe processuel de droit naturel, une règle inhérente à toute procédure, une exigence d’essence supérieure tel qu’analysé par Motulsky[98]. Matériellement, la mise en oeuvre du principe de loyauté peut conduire à forcer la manifestation de la vérité.
L’infraction d’apparence bâillonne le droit au silence obligeant la personne poursuivie à parler. La nécessité d’un comportement loyal de la part de celui-ci devrait avoir, au détriment de la présomption d’innocence, des effets bénéfiques sur l’établissement de la vérité. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination doit être lu avec les mêmes lunettes.
- Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination édulcoré
Le système pénal nous convie instamment à la prise de parole pour entraîner la manifestation de la vérité. Si une partie ou un tiers détient des éléments de preuve mais ne les produit pas, la recherche de la vérité exigerait que l’on force sa volonté. De façon équipollente, il garantit la prise de parole, par la protection de la présomption d’innocence. Dans sa dimension procédurale, le principe de la présomption d’innocence implique également pour la personne suspectée ou poursuivie, qui n’a pas à collaborer à la recherche de la vérité, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, de ne pas s’auto incriminer, c’est-à-dire de ne pas communiquer de renseignements ou indications permettant d’établir sa propre culpabilité est le pendant négatif du droit de se taire. Nemo tenetur se ipsum accusare. Nul ne peut être tenu de collaborer à sa propre accusation, nul ne peut être tenu de s’auto-incriminer. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est un principe juridique qui garantit à toute personne le droit de ne pas être contrainte de fournir des preuves ou des aveux qui pourraient la mettre en cause dans une procédure pénale. Il est destiné à protéger les personnes poursuivies contre l’auto-accusation (privilege against self incrimination). En pratique, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même, de s’avouer coupable ou encore de collaborer à la procédure. Corrélativement, les autorités pénales ne peuvent utiliser des moyens de preuves obtenus tant par la contrainte que contre la volonté de la personne poursuivie.
S’il n’a toujours pas connu de consécration textuelle par le législateur burkinabè ce principe fondamental de procédure pénale, « aux contours flous »[99], est reconnu tant en droit interne burkinabè que par le droit supranational[100] comme une composante du droit à un procès équitable. Le droit de ne pas s’auto-incriminer est consacré par la jurisprudence européenne depuis l’arrêt Funke c/ France[101]. Selon la Cour européenne, au stade de la recherche de la preuve, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est strictement lié au principe de la présomption d’innocence qui interdit à l’accusation de recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions au mépris de la volonté de l’accusé. Dans l’arrêt John Murray c/ Royaume-Uni du 8 février 1996, la Cour européenne affirmera explicitement : « même si l’article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable »[102].
Le délit d’apparence dans sa constitution renouvelle le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. L’infraction semble mettre en place un devoir particulier de communication, un devoir de loyauté à l’instar de ce qui se fait en matière douanière qui aboutit en quelque sorte à esquiver les principes classiques régissant la charge de la preuve.
En réclamant la production d’informations tendant à prouver l’inexistence d’un accroissement injustifié de son patrimoine, avec comme épée de Damoclès, la menace de sanctions pénales, les autorités de poursuite suscitent la preuve que doit fournir l’accusation. Elles aiguillonnent ainsi le prévenu à contribuer à sa propre incrimination et à renoncer de ce fait à la présomption d’innocence que lui garantit la loi.
L’approche ne manque pas d’interpeller. Peut-on considérer comme inéquitable le fait que le justiciable soit tenu d’informer en toute loyauté les autorités de l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa situation patrimoniale ? Le simple fait d’exiger une justification porte-t-il atteinte au principe de la présomption d’innocence ? Cette exigence de justification de son patrimoine et la sanction en cas de refus de s’acquitter de cette obligation viole le principe général consacrant le droit de ne pas témoigner contre soi-même, donc les droits de la défense. Toutefois, le principe n’étant pas absolu[103], sa relativisation par l’article 323-32 du code pénal burkinabè peut s’entendre. La justification est strictement morale et tient à l’existence d’un devoir de participer à la recherche de la vérité au profit de la paix sociale, d’une obligation de collaboration des citoyens à la défense de l’ordre public[104]. Elle n’est donc plus technique, mais philosophique.
De même, la procédure pénale est coercitive par nature[105]. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne fait pas obstacle à l’obtention d’informations par la coercition. La menace d’une sanction contenue dans l’article 323 est d’ores et déjà un moyen de coercition. Cette coercition participe de la théorie de l’acte coercitif, telle que développée par Philippe Collet et qui postule que parmi les actes de la procédure pénale exécutées par les autorités publiques, certaines sont de nature coercitives. Ces actes dont le trait commun est de porter atteinte aux libertés individuelles obéissent à des exigences constitutionnelles, conventionnelles et législatives telles que la légalité, la nécessité et la proportionnalité, la sauvegarde de la dignité de la personne. L’acte coercitif doit respecter les droits de la défense. Il doit encore pouvoir être contesté au moyen d’un recours juridictionnel. Il expose enfin son auteur à une sanction lorsqu’il constitue un abus d’autorité.
Au total, l’étude du délit d’apparence donne à voir que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est ébranlé. Cet ébranlement trouve des justifications théoriques. Plus largement, une telle infraction alors même qu’elle heurte les fondamentaux du droit pénal n’en demeure pas moins une infraction consacrée.
Conclusion
Lorsque l’on met l’infraction et l’apparence côte à côte, l’on offre conséquemment un écrin à l’expression du droit pénal. Rien de mieux que l’apparence dans la constitution de l’infraction pour que le droit pénal se meuve, se questionne et se redécouvre dans ses fondements. Toutefois, ici, il est plutôt question du délit d’apparence, c’est-à-dire que l’apparence est un indice déclencheur de la poursuite. Sous ce jour, il est clair que le sujet est d’intérêt, tant il renouvelle les classiques catégories des infractions ou la typologie des infractions.
En retenant la qualification d’infraction d’apparence, le législateur n’entend pas nécessairement créer une catégorie particulière d’infraction constituée sur la seule apparence. Il se fonde sur le fait que cette infraction est poursuivie à partir des indices relevés dans l’« apparence » que donne la personne ou la vie apparente qu’elle mène. L’infraction n’est constituée que faute par la personne poursuivie de justifier l’origine des ressources servant à son train de vie apparent. L’apparence n’est qu’un indice déclencheur de la poursuite comme elle peut l’être dans le cas de plusieurs autres infractions d’ailleurs. Elle ne fait pas à elle seule l’infraction. C’est donc plus une dénomination, un choix de mots, qui justifie l’approche de politique criminelle. Le délit d’apparence est prévu dans une approche de politique criminelle pour frapper les prédateurs de la fortune publique, mais pas seulement. Son rayon est plus large et couvre tous les pans de la vie sociale. Elle s’attache à développer les mécanismes de garantie d’une certaine éthique publique par la transparence de l’action publique.
L’attraction exercée par les apparences renforce en tout cas incontestablement l’influence du citoyen administré et donc la pression sociétale sur le système juridique. Le risque de manipulation qui en résulte, celui de remplacer la censure d’État par celle de l’opinion publique, n’est pas négligeable. Aussi faut-il ménager des garde-fous pour ne pas détourner le délit d’apparence de son objectif et ouvrir la voie à une forme de tyrannie des apparences ou une dictature de la transparence[106].
Une bonne loi doit pouvoir réprimer l’abus sans sacrifier la liberté. Le délit d’apparence est consacré et l’on n’a pas manqué de fustiger son caractère potentiellement liberticide, pouvant faire le lit aux règlements de comptes par voie judiciaire. Il révèle néanmoins les mécanismes à même de limiter l’intrusion de l’apparence pour protéger les libertés et de préserver l’équilibre entre les exigences de la transparence et celles de la liberté individuelle. La recherche de la vérité ne doit plus être le fardeau du seul ministère public, mais plutôt une charge partagée de tous les citoyens.
Références:


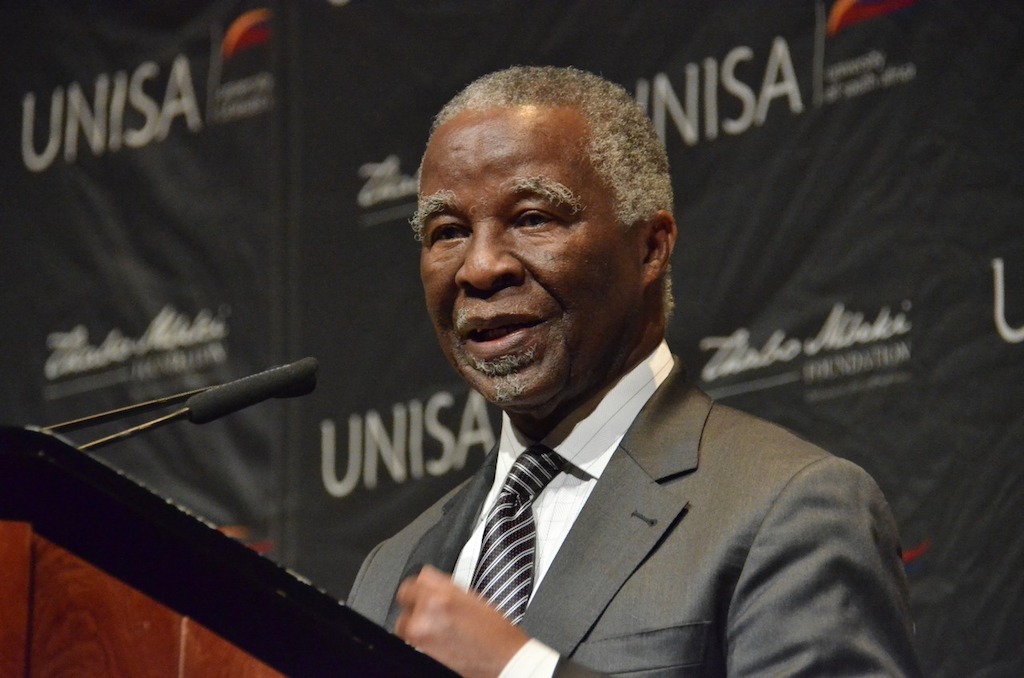

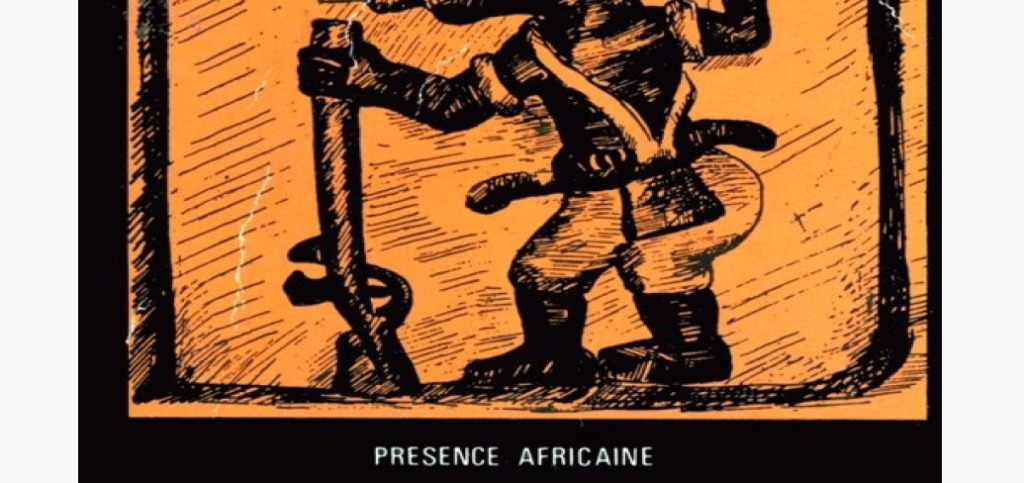
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.