Publication originale dans « Autour de la famille et de la terre, perspectives africaines du droit, Mélanges offerts au Professeur Ahonagnon Noël GBAGUIDI, Tome 2, la terre, Éditions du CREDIJ, 2023, pp. 391- 414. »
C’est en sa qualité de professeur invité à l’université de Lomé que j’eus la chance de rencontrer pour la première fois le dédicataire de ces Mélanges, le Professeur Noël A. Gbaguidi. Cette rencontre a, à plus d’un titre, structuré ma carrière universitaire. Pouvoir, aujourd’hui contribuer à ces mélanges me permet de lui rendre hommage et lui témoigner ma reconnaissance. La contribution du Professeur Gbaguidi pour un droit « endogénéisé », un droit tressé à l’ADN local est indéniable, aussi ai-je retenu de lui rendre hommage autour d’un phénomène actuel de nos sociétés, les réseaux sociaux dans leur appréhension par le droit.
« Dans les années 1960, on nous annonçait à grand renfort d’essais prophétiques plus ou moins affolés la fin de la Galaxie Gutenberg. L’image, c’est certain, allait triompher, et l’écrit, moribond, vivait ses dernières heures. On cesserait de s’écrire pour se téléphoner, se parler, où que l’on soit dans le monde. Le village planétaire serait débarrassé de la contrainte épistolaire, des lourdeurs de la correspondance. L’orthographe deviendrait une exigence fossile, quasi néandertalienne, puisque tous nos messages seraient véhiculés instantanément par l’oralité grâce aux ondes hertziennes ou satellitaires » écrivait Bernard Perier [1]. De tradition orale et nourri par les écrits puissants de Sembène Ousmane, une telle évolution nous aurait ravis. Cependant, un demi-siècle plus tard, le constat est simplement paradoxal. L’on ne s’est jamais autant écrit et l’on continue quand même à se parler ! S’il en va ainsi aujourd’hui, c’est que l’internet est passé par là et avec lui les réseaux sociaux auréolés d’une pratique à la Janus, tantôt vertueuse tantôt vicieuse. Celle-ci pose le débat de leur encadrement juridique.
Un réseau social est entendu, dans une approche sociologique, comme un ensemble de relations entre un groupe d’acteurs. Cet ensemble peut être organisé [2] ou non [3] et ces relations peuvent être de nature fort diverse. Il peut s’agir de relation de pouvoir, d’échanges de cadeaux, de conseil, de relations spécialisées ou non, symétriques ou non [4]. Les acteurs du réseau sont en général des individus, mais il n’est pas surprenant d’observer également des ménages, des associations, etc [5]. Relativement au numérique, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou non. Les réseaux sociaux en ligne désignent également les sites internet et applications mobiles qui permettent des interactions sociales [6] organisées selon des profils dans plusieurs domaines [7] en fonction de certains critères tels que l’âge et les centres d’intérêts. Ils favorisent le réseautage social ou le social networking.
Les réseaux sociaux constituent un espace hybride, mêlant insidieusement le public et le privé, où « tous les types de paroles sont égalisés par une immédiateté et une forme d’impunité, qui encouragent les excès, le mélange des genres » [8]. L’analyse des réseaux sociaux permet une comparaison avec l’espace public égalitaire de discussion que Jürgen Habermas [9] considérait comme la condition véritable de la démocratie. Sur les réseaux sociaux, la liberté d’expression et de partage atteint son acmé, donnant naissance à un modèle horizontal de débat et d’organisation. Ce modèle semble, à première vue, rentrer en contradiction frontale avec le droit positif qui postule un modèle vertical [10], pyramidal tel que théorisée par Hans Kelsen [11]. Le couple réseau sociaux et droit apparaît alors comme un couple antagoniste. Les échanges et les liens sur les plateformes de réseaux sociaux sont friables et évanescents. Ils peuvent être opposés aux liens plus solides créés par la famille et par les institutions [12].
L’arbre généalogique des réseaux sociaux est facile à réaliser. Une filiation peut être établie avec l’avènement d’Internet, lui-même issu de la révolution de l’informatique, qui n’est que la descendante de la révolution numérique. L’histoire des réseaux sociaux nous renvoie à ses origines dans les forums, groupes de discussion et salons de chat introduits dès les premières heures de l’internet. Comme tout phénomène nouveau, les réseaux sociaux posent beaucoup de questions, aussi bien sur le plan sociologique qu’économique, sur la nature des relations nouées sur les réseaux, sur leur intégration dans nos différentes sociétés et modes vies au quotidien.
A n’en point douter, les réseaux sociaux constituent le reflet de la « crise de la société ». L’on observe aujourd’hui que sur les réseaux sociaux, « le voile de la politesse, du respect d’autrui, de l’écoute réciproque se déchire, laissant apparaître l’hydre du sarcasme, de l’égotisme, de l’injure et de la haine de l’autre » [13]. Arnaud Mercier identifie ces comportements comme un « ensauvagement du web », entendu comme « usage transgressif et agressif des dispositifs numériques d’expression qui rompt avec les règles de civilité ordinaires fondatrices du pacte social » [14]. Ces comportements déviants sur les réseaux sociaux pourraient s’expliquer par une combinaison entre des dispositifs technologiques et des mécanismes psychologiques [15]. L’auteur cite l’anonymat dissociatif [16], l’impunité communautaire [17], l’effacement du visage d’autrui [18], la levée du refoulement sur la haine [19], la logique du coup d’éclat permanent [20], le côté obscur de la « culture LOL » [21], le bannissement de la subtilité et du temps du raisonnement [22].
Les réseaux sociaux semblent caractériser l’innovation comme « source de croissance et facteur de crise » [23]. Guillaume Von der Weird écrit à ce propos, « comme tout nouvel outil, les réseaux sociaux engendrent de mauvais usages, en particulier par leur logique de réduction du temps de réflexion » [24] puisque « l’internet fait disparaître l’espace et le temps (espace de séparations, temps de réflexion) [25]».
Aussi, très rapidement à l’instar de l’internet, un questionnement fondamental n’a-t-il pas manqué de se faire jour relativement à l’aptitude du droit à encadrer les réseaux sociaux dans l’ordre juridique togolais. L’évidence et la banalité de la question occultent mal la complexité de la réponse. Une première piste a été explorée. Elle consistait à envisager les réseaux sociaux comme un nouveau monde, un monde parallèle qui échappe à la réglementation positive. M. Lawrence Lessig défendait, dans le même ordre d’idées, l’existence d’une véritable souveraineté du cyberespace, c’est-à-dire un pouvoir certes non centralisé mais tout de même autonome et réfléchi [26]. Cette souveraineté rentrerait en compétition avec les différentes souverainetés nationales [27]. Une telle piste s’est révélée aporétique. Une autre piste a envisagé les réseaux sociaux comme des faits sociaux nouveaux [28] et comme tels, ils pouvaient être appréhendés par le droit. C’est cette deuxième piste qui a prospéré. Cependant à l’analyse, elle a révélé l’une des infirmités non dirimantes du droit. Celui-ci a toujours un train de retard sur les évolutions sociales, posant la question de son adaptation. En effet, le défaut de territorialité du web semble exclure la compétence des ordres juridiques nationaux. Le territoire étant la limite naturelle du droit, l’État qui a le monopole de la puissance légitime [29] doit envisager une « reterritorialisation du droit » par divers autres mécanismes comme les politiques publiques, la contrainte et la coopération. Toutefois, en droit pénal, il n’y a pas besoin de procéder à cette « reterritorialisation », dans la mesure où la localisation de l’infraction rend à l’État sa compétence. La communication virtuelle [30] a la particularité d’entretenir un relatif anonymat, qui est propice à tous les actes répréhensibles inhérents à la nature humaine. Or, l’immédiateté, l’impunité, les excès qui le caractérisent ne font pas bon ménage avec le droit.
L’un des éléments clés de la justiciabilité des comportements des individus sur les réseaux sociaux est indubitablement le caractère public ou privé de la communication qui est effectuée. En droit togolais le législateur définit la communication au public par voie électronique comme « toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signe, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » [31]. Il ne définit, cependant pas la communication privée [32]. La jurisprudence et la doctrine n’offrent pas non plus de définition, ce qui impose une analyse a contrario. Cette analyse n’est pas aisée, car il est ardu d’identifier un critère objectif de distinction entre ce qui relève de la communication dans un cercle privatif et celle destinée au public. Il faut donc retenir que toute communication destinée à une personne indéterminée ou non individualisée serait une communication publique. Ici, l’identité du destinataire importe peu pourvu qu’il ait l’information.
En droit comparé, la jurisprudence française a retenu un critère dissocié de toute référence au nombre de personnes destinataires du message. Le Tribunal de grande instance de Paris [33] avait ainsi retenu le critère de la communauté d’intérêts comme critère de distinction entre une communication à caractère privé et une communication publique. La notion de « communauté d’intérêt » peut être définie par « l’appartenance commune, des inspirations ou des objectifs partagés, (…) des personnes qui forment une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçues comme regroupant des tiers par rapport à l’auteur des propos » [34]. Le critère de la communauté d’intérêts a également été repris par la Cour d’appel de Paris [35]. Au total, la notion de « communauté d’intérêts » exclusive de publicité se caractériserait par un regroupement de personnes sélectionnées par affinités amicales ou sociales [36]. Le critère de la communauté d’intérêts semble congruent aux communications sur un réseau social, puisque des études sociologiques démontrent que le regroupement d’individus du fait de leurs affinités ou centres d’intérêts est le but premier de ces réseaux. Il emporte notre adhésion.
La Cour de cassation française a retenu, quant à elle, que ce qui détermine la nature privée d’une conversation tenue sur un réseau social sur internet, directement ou par le truchement du critère de la communauté d’intérêts des destinataires [37] est tout d’abord le fait que les personnes y ayant eu accès ont été agréées par l’auteur des propos. La notion d’agrément « renvoie au paramétrage d’un compte par lequel l’auteur restreint la visibilité des contenus qu’il publie à ses seuls contacts excluant ainsi l’accès auxdits contenus aux tiers, comme les contacts de ses contacts » [38].
Il faut donc retenir que sur un réseau social, dès lors que les propos peuvent être vus, écoutés, lus, consultés par des personnes dépassant le cadre des contacts de l’auteur, ils ont un caractère public. Toutes les fois que les destinataires [39] sont indéterminés, il faut en déduire le caractère public de la communication. La détermination du nombre ou de l’audience de la communication reste évidemment une question de fait. En revanche, la communication reste privée lorsqu’elle est adressée à « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et des objectifs partagés, formant une entité suffisamment fermée pour ne pas être perçue comme des tiers par rapport à l’auteur des propos mis en cause » [40].
Concrètement, une information publiée sur une page Facebook est publique si le compte est paramétré pour être accessible à tout le monde. Si le compte est paramétré pour être accessible à ses amis ou à un groupe restreint, l’information qui y est publiée est privée. Une information publiée dans un groupe WhatsApp fermé serait privée alors qu’une information publiée sur un profil pourrait être publique. Une information publiée sur Twitter serait publique en fonction du paramétrage retenu. Au total, le caractère public de la diffamation ou de l’injure commise sur un réseau social dépendra des mesures d’accès que leur auteur aura prises : si le compte sur le réseau est accessible à tout un chacun, la diffamation ou l’injure sera publique. Elle sera, en revanche, non publique si l’accès est restreint et ouvert aux seuls « amis » de l’intéressé. En fonction du caractère public ou privé des infractions, la sanction sera à l’avenant.
Une fois le critère de la justiciabilité des comportements délictueux sur les réseaux sociaux admis, l’on peut relever que les questionnements proposés par les réseaux sociaux sont, pour la plupart, connus. Seule la manière d’y répondre devra être adaptée à la réalité des réseaux sociaux et à leurs spécificités. Parmi les problèmes juridiques posés par les réseaux sociaux, beaucoup sont liés aux atteintes aux droits de la personne (I). Toutefois, la capacité de résonance de ces réseaux induit une contamination du groupe social (II) par ces problématiques.
I. LES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PERSONNALITÉ
Celui qui voit utiliser son patronyme ou une copie de sa photographie par un tiers, ou qui lit sur les réseaux sociaux des révélations sur sa vie privée éprouve un sentiment d’aliénation. On lui vole une partie de lui-même. Une atteinte intolérable est ainsi portée à sa personnalité. Cette atteinte peut donc concerner le nom, l’image, l’honneur et la réputation, le secret de la vie privée. Il est permis d’y ajouter les œuvres de l’esprit, qu’elles soient littéraires ou artistiques. La personnalité demeure protégée même sur les réseaux sociaux et elle l’est doublement. Il s’agit notamment d’une protection pénale (A) et d’une protection civile (B).
A. La protection pénale de la personnalité
Sur les réseaux sociaux, la vie privée est doublement menacée. D’une part, les réseaux sociaux incitent les utilisateurs à dévoiler eux-mêmes leur vie privée (leurs occupations, leurs goûts, les comportements). D’autre part, certaines personnes peuvent grâce aux réseaux sociaux collecter des informations afin de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Ces menaces peuvent générer des atteintes à l’honneur (1) et des atteintes à l’intimité de la vie privée (2). Celles-ci ouvrent la voie à des condamnations pénales.
- Les atteintes à l’honneur
L’atteinte à l’honneur est définie à l’article 289 du code pénal comme « … tout acte dirigé contre la marque de considération, l’égard dû au rang, le témoignage d’estime ou l’hommage rendu à la valeur d’une personne ». Elle peut tenir soit en une diffamation ou en une injure. D’abord, s’agissant de la diffamation, aux termes de l’article 290 du code pénal, toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, impute à autrui un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation [41]. La souplesse de l’article 290 du code pénal [42] permet une extension de son champ d’application aux réseaux sociaux. Cette souplesse est accentuée dans la mesure où l’infraction est également constituée par « la publication directe, ou par voie de reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation ». En somme, aussi bien l’implication directe que la reproduction d’une allégation diffamatoire sont punissables.
La jurisprudence française retient que, pour être diffamatoire une allégation [43] doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire[44]. Autrement dit, c’est imputer un fait précis à autrui, c’est-à-dire un acte, un comportement, qu’il serait possible de prouver s’il était vrai [45]. Ainsi, le fait d’imputer à autrui un comportement constitutif d’une infraction pénale[46] ou un manquement à la morale[47] relève de la diffamation. L’objet de l’atteinte doit être l’honneur ou la considération du public. Par exemple, traiter un individu d’« ivrogne » [48].
Ensuite, relativement à l’injure, il s’agit de toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait [49]. Le caractère imprécis des propos ou écrits permet la qualification. Ainsi, aux termes de l’article 298 du Code pénal, toute personne qui, publiquement ou par écrit, adresse de façon violente à autrui une injure, sera punie d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA. Si l’injure comporte un terme de mépris tenant au sexe, au genre, au handicap, à l’appartenance raciale, ethnique, religieuse ou nationale, à la séropositivité VIH de la victime, l’auteur sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et l’amende pourra être portée au double. Il faut y ajouter les injures dirigées contre la mémoire des morts[50]. L’article 17 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité [51] offre également une piste pour l’incrimination et la sanction de l’injure commise par le biais d’un système informatique [52]. A titre d’exemple, est constitutif du délit d’injure le fait de qualifier un tiers d’« affairiste » [53], de « triste con » ou de « dangereux salaud » [54].
L’élément essentiel du délit en matière d’injure et de diffamation est bien entendu la publicité [55]. La diffamation et l’injure ne constituent des délits que si les propos ont été tenus publiquement. A titre d’exemple, des propos tenus sur un réseau social et accessible à tout internaute sont punissables. Le législateur n’a pas prévu les hypothèses de diffamation et d’injure non publiques [56]. La diffamation et l’injure sont non publiques quand les propos sont adressés par leur auteur à la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente. Rentrent dans cette catégorie, les propos envoyés par SMS ou prononcés par leur auteur devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, en la présence ou en l’absence de la victime [57].
Lorsque la diffamation se trouve caractérisée, l’auteur des écrits ou des propos litigieux dispose de la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant d’une part, la preuve de la vérité des faits dénoncés (exceptio veritatis [58]) et d’autre part, la preuve de sa bonne foi. En matière d’injure, il ne peut, par définition, y avoir d’offre de preuve (faute de fait précis) et, s’agissant de l’élément intentionnel, la responsabilité de propos ou écrits injurieux ne pourra être écartée qu’en cas d’excuse de provocation. Les atteintes peuvent également concerner l’intimité de la vie privée.
- Des atteintes à l’intimité de la vie privée
Les réseaux sociaux peuvent constituer un vecteur de la violation de l’intimité de la personne. Une telle infraction peut être caractérisée lorsque d’une part, l’on publie ou diffuse des papiers ou enregistrements privés, un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l’image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit [59]. Le droit à l’image impose que toute personne ait le droit de disposer de son image et conséquemment de s’opposer à la publication, à la diffusion ou à l’utilisation de son image. Concrètement, avant de publier une photo sur laquelle apparaît une personne, il faudrait obtenir son consentement préalable. Cette demande est faite au nom du respect de la vie privée dont le droit à l’image constitue un outil de protection. Il faut préciser que le fait qu’une personne accepte d’être photographiée n’implique pas automatiquement son consentement à la publication.
D’autre part, une telle violation est caractérisée par le fait d’organiser, par quelque procédé que ce soit, l’interception, l’écoute ou l’enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges reçus dans un lieu privé, à l’insu ou sans l’accord des personnes en communication ou du maître des lieux [60].
Enfin, les réseaux sociaux peuvent être le medium d’infractions telles que le chantage [61], le revenge porn et le harcèlement. En droit togolais, le chantage est prévu et puni par le code pénal [62]. Le revenge porn est une violation délibérée de la vie privée intime d’autrui par la transmission ou l’affichage d’un contenu sexuellement explicite (une image, un audio ou une vidéo) d’une personne qui est dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci [63], dans un but de vengeance ou d’extorsion. Ce comportement n’est pas expressément prévu par le législateur mais tombe sous le coup de plusieurs dispositions pénales, notamment l’atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la dignité, le droit à l’image.
Le harcèlement est édicté sous la rubrique des attentats contre les mœurs. En effet, aux termes de l’article 299 du Code pénal, « Constitue un harcèlement sexuel, le fait pour une personne d’user d’ordres, de menaces, de contraintes, de paroles, de gestes, d’écrits ou tout autre moyen dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle ». Il s’agit bien entendu d’une infraction classique [64], mais elle trouve une « nouvelle jeunesse » à travers les réseaux sociaux qui peuvent en faciliter la commission. L’infraction est caractérisée par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’anonymat relatif des réseaux sociaux est un véritable comburant pour le développement de cette forme de harcèlement. Le harcèlement sexuel commis avec les TIC et notamment sur les réseaux sociaux n’échappe pas à la sanction prévue par l’article 300 du code pénal, à savoir une peine d’emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines [65].
Il faut souligner l’étroitesse du domaine du harcèlement retenu par le législateur togolais. En effet, celui-ci ne prend en considération que le harcèlement sexuel. Or, il est indubitable que les formes du harcèlement sont plurielles. A côté du harcèlement sexuel, l’on note le harcèlement moral. Et, cette dernière forme de harcèlement, qui peut être la plus insidieuse, n’a pas eu l’heur de retenir l’attention du législateur [66]. L’approche retenue ne semble pas non plus procéder d’une « qualification unique de harcèlement » [67]. Aujourd’hui il faut certainement avoir une vue plus globale du harcèlement, et l’étendre au cyberharcèlement. Celui-ci peut être défini comme un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus, de manière répétée dans le temps, au moyen des technologies d’information et de communication pour porter délibérément atteinte à un individu qui ne peut facilement se défendre seul [68]. Il peut se manifester par l’humiliation, les moqueries, les injures, la diffamation, le discrédit, l’intimidation, l’usurpation d’identité́, les menaces physiques, les prises de contact insistantes. Le cyberharcèlement n’est pas en soi une infraction réprimée en tant que telle par la loi togolaise, l’auteur d’actes accomplis à cette fin est toutefois susceptible de voir engager sa responsabilité́ sur le fondement du droit civil, du droit de la presse ou du code pénal. La protection de la personnalité s’observe aussi de manière spécifique au plan civil.

B. La protection civile de la personnalité
Dans les cas non prévus par les dispositions pénales, la personnalité bénéficie d’une large protection grâce au droit civil. L’individu a le droit de préserver de toute atteinte les principaux aspects de sa personnalité. Ces droits sont reconnus par la Constitution togolaise, la loi et la jurisprudence. Il s’agit notamment du droit au respect de sa vie privée [69] (1) ; et du droit au respect de la présomption d’innocence [70] (2).
- Le droit au respect de la vie privée
Le Code civil dans sa rédaction du 1er mai 1956, en vigueur au Togo, observe un silence éloquent relativement au droit au respect de la vie privée. Toutefois, l’article 28 alinéa 2 de la Constitution togolaise règle la difficulté. Il dispose que « Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image ». Une analyse comparative avec le droit français dévoile la richesse d’une telle disposition. En effet, selon l’article 9 du code civil français : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
La jurisprudence de la Cour de cassation française est claire sur ce point. Toute photo d’ordre privé, c’est-à-dire à l’exclusion des photos de personnes dans l’exercice d’une fonction publique, nécessite une autorisation pour qu’elle soit diffusée au public. Ainsi, la diffusion d’une photo d’un tiers, d’ordre privé, à condition qu’elle soit faite dans le cadre d’un cercle très restreint de famille ou de proches, est possible, même en l’absence d’autorisation de la personne concernée. Cependant, dès lors qu’il y a diffusion « au public », son accord exprès est requis. La photo d’un individu diffusée sur les réseaux sociaux sans son consentement tombe sous le coup de la loi dès lors que la diffusion est faite « au public ». Ce n’est pas parce que l’information que l’on a relayée est vraie que l’on ne se rend pas coupable d’une faute. Quid de la situation d’une personne se trouvant sur une photo de groupe ? Il nous semble que cette situation ne déroge pas au principe posé plus haut. L’assentiment de tous doit être obtenu avant la publication de la photo sauf à occulter le visage de celui dont l’accord n’a pas été obtenu [71].
Sur le droit à l’image, une autre question s’est posée relativement à l’individu qui lui-même a diffusé des informations reprises par d’autres. La Cour Européenne des droits de l’Homme a tranché la difficulté dans un arrêt du 23 juillet 2009 dans lequel elle a posé le principe selon lequel « les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles » [72]. En effet, selon un principe général du droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Un tempérament à ce principe a été prévu : les propos doivent être repris sans être « déformés » ou « détournés ». L’on peut en déduire avec Claire Strugala, que les révélations préalables de l’intéressé affaiblissent son droit à la protection de sa vie privée, ce qui ne signifierait pas nécessairement l’« anéantissement » de ce droit [73]. La vie privée est protégée au plan civil contre les atteintes qu’elle peut subir. Le droit au respect de la présomption d’innocence vient compléter l’arsenal.
- Le droit au respect de la présomption d’innocence
Le principe de la présomption est encadré par l’article 18 alinéa, 1er de la Constitution togolaise. Aux termes dudit texte, « tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense ». Le principe de la présomption d’innocence signifie alors qu’un individu est innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée par un jugement irrévocable[74]. En pratique, toute personne accusée d’une infraction pénale, doit être considérée et traitée comme innocente dès lors que sa culpabilité n’a pas été légalement établie par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée, quelle que soit la gravité de l’infraction commise et la véracité des charges existantes. La flagrance du délit ou du crime est indifférente. En conséquence, son identité et les faits qui lui sont reprochés ne devraient, en principe, recevoir aucune publicité en dehors de la phase du jugement [75].
Or, il est commun de remarquer que les images de voleurs présumés, les messages audio accusant des tiers de méfaits foisonnent sur les réseaux sociaux au mépris de la présomption d’innocence. De tels messages portant manifestement atteinte à la personne de ces individus peuvent évidemment engager la responsabilité de leurs auteurs.
La présomption d’innocence est un principe constitutionnel et sa protection est à l’avenant. L’article 18, alinéa 2 érige le pouvoir judiciaire en gardien de la liberté individuelle et du respect du principe de la présomption d’innocence dans les conditions prévues par la loi [76]. Cette protection est organisée tant au plan civil qu’au plan pénal [77].
Sur le plan civil, l’atteinte portée à la présomption d’innocence peut mettre à mal la liberté et la réputation du suspect. Le préjudice ainsi causé peut s’analyser en un préjudice matériel, économique ou moral. Dès lors, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, le juge civil peut condamner l’auteur de l’atteinte au paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la violation de la présomption d’innocence. Il s’agit des mesures complémentaires des peines principales. Le juge peut également condamner l’auteur de l’atteinte à publier un communiqué rectificatif aux fins de faire cesser l’atteinte. Ce communiqué est bien entendu aux frais de la personne physique ou morale responsable de cette atteinte.
En somme, lorsque l’atteinte à un droit de la personnalité est établie, l’auteur est condamné à verser à sa victime des dommages-intérêts en application des principes de la responsabilité civile contenus dans les articles 1382 et suivants du Code civil. A part l’individu, le groupe social, dans ses diverses composantes, est également exposé aux atteintes.
II. LES ATTEINTES AU GROUPE
Les réseaux sociaux avec leur particularisme sont moins restrictifs. Les contrôles sont limités et l’information est relayée avec une célérité sans commune mesure. Certaines de ces actions peuvent porter atteinte soit à l’ordre public (A) ou aux représentants de l’autorité publique (B).
A. Les atteintes à l’ordre public
L’ordre public est une notion polysémique et difficile à définir. Dans un sens général, l’on peut retenir que pour un pays donné, à un moment donné, l’ordre public est « l’État social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées » [78]. Cet État subit régulièrement les assauts des réseaux sociaux. En effet, les citoyens publient, diffusent ou reproduisent des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers (1). Cet état de fait facilité par le copier-coller ou la fonction transfert des smartphones et autres tablettes est susceptible de troubler la paix publique ou ébranler le moral des armées (2).
- La diffusion de fausses nouvelles
La fausse nouvelle consiste en des informations fausses, des pièces fabriquées, falsifiées voire mensongères et basées sur la mauvaise foi, du moment que celles-ci ont été reconnues comme de nature à troubler l’ordre public. Il n’est pas toujours aisé d’isoler le vrai de l’ivraie. La diffusion de fausses nouvelles consistant à publier, diffuser ou reproduire, par n’importe quel moyen, ces informations fausses est caractéristique d’une infraction pénale.
Dès lors que la fausse nouvelle [79] a été publiée, diffusée ou reproduite et attribué à des tiers par des individus de mauvaise foi, ces derniers tombent sous le coup de la loi pénale [80]. L’article 25 de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité envisage, dans la même veine, la diffusion de fausses nouvelles tendant à faire croire à une situation d’urgence. Aux termes de cet article, « quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise ou toute autre situation d’urgence, est puni d’un (1) à trois (3) an (s) d’emprisonnement et d’un (1) million à trois (3) millions de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines ».
Les éléments constitutifs de ce délit sont : la publicité, le caractère faux de la nouvelle ou de la pièce falsifiée ou mensongèrement attribuée, le trouble à la paix publique et l’intention coupable. Relativement à la publicité, l’article 498 du Code pénal adopte une conception large et souple pour favoriser l’adaptation dans le temps de la disposition. Ainsi les modes de publicité, de diffusion et de reproduction sont indifférents. Quel que soit le moyen retenu, seule la finalité importe. L’on peut valablement estimer que les discours, les messages, les menaces proférés sur les réseaux sociaux ; les écrits, les imprimés, les dessins, les gravures, les photomontages, les peintures, les emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image distribués à travers les réseaux sociaux, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposés au regard du public.
La question de la publicité peut être discutée. L’article 489 du Code pénal ne semble pas poser comme une exigence que le lieu où les propos constitutifs d’une fausse nouvelle ont été tenus soit public. Il faut sans doute en déduire que c’est la volonté de diffuser des fausses nouvelles qui prime ici. En droit comparé, il a été jugé que la loi ne fait résulter le délit « que de la volonté de publier et de la publication, c’est-à-dire de cette circonstance que les fausses nouvelles ont été répandues dans le public, et non de la nature du lieu où elles ont commencé à se produire » [81].
D’abord, la nouvelle est entendue comme l’annonce à quelqu’un qui n’en a pas encore connaissance d’un évènement survenu récemment [82]. La nouvelle doit donc avoir trait à un événement ou un fait d’actualité. Il faut conséquemment exclure le récit d’un fait passé ou, à tout le moins, déjà connu du public. Au surplus, l’expression d’une opinion ne saurait constituer une fausse nouvelle [83]. La fausseté de la nouvelle est analysée objectivement et il s’agit d’une question de fait qui est appréciée souverainement par les juges du fond, sous réserve toutefois que leurs constatations soient exemptes d’ambiguïté ou de contradiction.
Ensuite, une nouvelle trouble la paix publique lorsqu’elle provoque des désordres, des mouvements de panique ou, du moins, des inquiétudes graves, des émotions collectives [84]. En l’absence de troubles publics susceptibles d’être réalisés, le délit de fausses nouvelles n’est pas constitué. La loi exige un lien de cause à effet entre la fausse nouvelle et le trouble. L’appréciation de l’existence ou de la virtualité du trouble se fait in concreto, en fonction des données propres à chaque espèce.
Enfin, l’intention coupable ou la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance de la fausseté de la nouvelle par celui qui la diffuse. La preuve de la mauvaise foi ne peut être induite de la seule constatation de la fausseté de la nouvelle [85]. En l’espèce, c’est le ministère public qui dispose du monopole de la poursuite.
A côté de la diffusion de fausses nouvelles, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est prévue et sanctionnée par le code pénal [86]. Une autre atteinte particulière concerne le moral des armées.
- L’atteinte au moral des armées
L’infraction d’atteinte au moral des armées, alors même qu’elle est prévue par le législateur, reste difficile à définir. Que faut-il entendre par l’expression « moral des armées » ou encore comment déterminer la fausse nouvelle de nature à ébranler ce moral ? Le Général de Négrier définit le moral comme l’élément essentiel des armées. Pour lui, le moral des troupes postule que les soldats d’une troupe se connaissent, qu’ils développent des aptitudes physiques et mentales, un esprit de corps et qu’ils aient confiance les uns en les autres [87]. Le chef d’escadrons E. Guérin renchérit en retenant que « La force morale d’une armée n’est pas uniquement la somme des forces morales individuelles. Elle s’appuie aussi sur la force de la confiance collective, celle placée dans le groupe au sens large. Cette synergie positive influera fortement sur l’efficacité opérationnelle du groupe. La confiance collective de ses membres s’acquiert par la vie en commun » [88].
La définition, on peut l’observer, n’est pas aisée. L’armée formant un groupe et une entité ; déterminer un moral commun à ce groupe est une véritable gageure. De même, il ne faut pas perdre de vue que l’interrogation concerne un groupe qui est justement formé pour résister et faire face aux situations les plus extrêmes, que ce soit au plan physique qu’au plan moral.
En droit comparé, cette infraction est contestée sur la base des réserves de sa compatibilité avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour Deffains et Thierry, « il est permis de douter, au vu de la rareté des poursuites, de sa nécessité dans une société démocratique à la poursuite du but légitime de protection de l’ordre et de la sécurité nationale. Mais, plus encore, la formulation vague de l’incrimination permet de douter qu’elle réponde à l’exigence de prévision posée par l’article 10, paragraphe 2, de la Convention » [89]. Une clarification jurisprudentielle serait la bienvenue.
En tout état de cause, le législateur retient que la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles faite de mauvaise foi peut avoir pour objectif ou peut être de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. Dans un tel cas de figure, selon l’article 497, alinéa 3 du code pénal, l’auteur de l’infraction sera puni d’une peine d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende. De même, l’article 656 – 2 du code pénal punit d’une peine de cinq (05) à vingt (20) ans de réclusion criminelle toute personne qui, en temps de paix participe par des tracts, des affiches, ou des rumeurs entretenues par quelque moyen que ce soit, à une campagne portant atteinte au moral ou à la discipline des armées.
B. Les atteintes aux représentants de l’autorité publique
Les réseaux sociaux offrent un espace large de discussions, débats et polémiques. Derrière l’écran de leurs téléphones, les individus sont plus à l’aise pour proférer des injures à l’encontre des représentants de l’autorité publique. Le contexte sociopolitique fait le lit de tels actes. Toutefois à l’instar du monde réel, le monde virtuel n’échappe pas aux fourches caudines du droit. Aussi, la diffamation et l’injure commises envers les représentants de l’autorité publique n’emportent-elles pas moins sanction (1). De même l’abus de la liberté d’expression envers lesdits représentants peut, elle aussi, appeler la réaction de la loi (2).
- La diffamation et l’injure commises envers les représentants de l’autorité publique
La lecture du code pénal renseigne sur « la radicalisation de l’expression du monopole de la violence physique par l’État » [90]. L’on y découvre un abaissement du seuil de tolérance aux incivilités exprimées par les citoyens à l’encontre des dépositaires de l’autorité publique. Ainsi, l’offense commise publiquement envers le chef de l’État, le chef du gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, les membres du gouvernement, les membres du parlement, les présidents des institutions de la République prévues par la constitution est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende d’un million (1.000.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines [91]. Il faut entendre par offense une injure, un outrage, une atteinte à l’honneur, à la dignité, à la considération d’une personne adressé hors de leur présence aux personnes citées plus haut. Commises sur les réseaux sociaux, ces infractions restent soumises aux mêmes peines.
Il en va de même de l’outrage commis publiquement envers les chefs de mission et autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République togolaise. Il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines [92].
En ce qui concerne, la diffamation envers les cours et tribunaux, les forces armées et forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, de même que envers les ministres des cultes, les dignitaires, des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins du fait de leur déposition en raison de leurs fonctions ou de leur qualité [93], est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une des deux peines lorsqu’elles sont commises par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique [94].
- L’abus de liberté d’expression envers les représentants de l’autorité publique
La liberté d’expression est un droit fondamental consacré par la constitution. Son abus vis-à-vis de certaines personnes peut être constitutif d’outrage. Le cas particulier des représentants de l’autorité publique est à relever. Régulièrement, les représentants de l’autorité publique sont l’objet d’outrages. L’on entend par outrage, une offense, une manifestation de mépris qui constitue un délit lorsqu’elle est adressée, par parole, geste, menace, écrit ou image, attentatoire à la dignité de sa fonction, à une personne dépositaire de l’autorité public, à un agent public ou à un magistrat dans ou à l’occasion de l’exercice de sa profession [95]. L’actualité sociopolitique a vu fleurir sur les réseaux sociaux des outrages envers des représentants de l’autorité publique. Une telle infraction est prévue et punie par le code pénal. En effet, aux termes de l’article 490 du code pénal, « constituent des outrages envers les représentants de l’autorité publique, le fait par paroles, écrit, geste, images, objets ou message enregistré non rendus publics d’injurier ou outrager dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d’un ministère de service public ». Les outrages sont étendus aux symboles et emblèmes de l’État. Ainsi sont également incriminés tous les actes, paroles ou gestes de nature à porter atteinte au respect et à l’honneur dus au drapeau et à l’hymne national [96].
Les personnes reconnues coupables d’outrages envers les représentants de l’autorité publique, seront punies d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines [97]. La peine est aggravée en cas de publicité de l’outrage [98].
En conclusion, « l’imaginaire entretient le rêve quand la réalité actuelle démythifie absolument tout » [99]. Il est par trop rapide de penser que les réseaux sociaux échappent à l’ordre juridique. Au vrai, les réseaux sociaux se laissent saisir par les catégories juridiques qui nous sont familières. Puis ils influent sur les catégories juridiques pour provoquer leur adaptation. Plus spécifiquement, les réseaux sociaux nous questionnent sur notre entrée dans le post-humanisme. Notre rapport aux technologies impose, il va sans dire, un changement inéluctable. C’est le degré de ce changement qu’il nous appartient de déterminer [100]. Comment faire pour que les réseaux sociaux ne se transforment pas des fléaux sociaux ? Faut-il envisager un nouveau système de valeurs organisant les relations humaines ? Certains auteurs n’ont pas manqué de franchir le pas en proposant une révision des « conceptions sociologiques, éthiques, politiques et culturelles dans le rapport de l’homme avec lui-même et à la machine [101] ». D’autres estiment qu’il est nécessaire de ralentir ou de renverser cette évolution qu’ils perçoivent comme une dégradation [102]. Nous opinons pour la première démarche, elle est la plus congruente au genre humain. L’humain s’est toujours adapté. L’humanité s’est constamment adaptée. En l’espèce, le modèle d’adaptation devrait être construit autour de l’éducation citoyenne sous la responsabilité de l’État et des autres acteurs impliqués. C’est un réel enjeu à l’échelle de nos États : éduquer les citoyens à un usage responsable et raisonné des technologies.
Agoè Fiové, le 17 avril 2020
Akodah AYEWOUADAN
Références
[1] B. Périer, La parole est un sport de combat, JC Lattès, 2017, p. 49.
[2] Par exemple, une entreprise.
[3] Par exemple un réseau d’amis.
[4] V. Lemieux, Les réseaux d’acteurs sociaux, PUF, 1999, coll. « Sociologies », 1999.
[5] M. Forsé, « Définir et analyser les réseaux sociaux. Les enjeux de l’analyse structurale », Caisse nationale d’allocations familiales, « Informations sociales », 2008/3 n° 147, pages 10 à 19, spéc. p. 1. Disponible à https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-3-page-10.htm (consulté le 12 décembre 2019).
[6] Les interactions sociales peuvent se faire entre individus, groupes d’individus ou organisations.
[7] Il peut s’agir de l’amitié, de l’amour, de relation professionnelle ou même politique.
[8] G. von der Weird, « Quelle justice sur les réseaux sociaux », Les cahiers de la justice, 2017/3, p. 523.
[9] J. Habermas, De l’éthique de la discussion, Champs Flammarion, 1992.
[10] F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires de Saint Louis, 2002. Selon ces auteurs, le paradigme de « la pyramide » aurait vécu et ferait place à celui du « réseau ». Pour eux les systèmes juridiques ne sont pas organisés hiérarchiquement et le positivisme ne permet pas d’expliquer le droit. Au surplus, l’État n’est plus le seul cadre de référence lorsque l’on veut penser le droit. De même qu’il n’y a pas un seul ordre juridique mais une myriade de systèmes entretenant entre eux des rapports complexes.
[11] H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2e édition, traduite par Charles Eisenmann, Dalloz, 1962.
[12] Th. Rogel, Le changement social contemporain, Bréal,2003, « Thèmes et Débats sociologie, p. 45 et s. « Le déclin des institutions et de la famille conjugale ainsi que l’essor des familles recomposées réduisent le poids des institutions et des relations hiérarchisées ».
[13] A. Mercier, « Un processus de décivilisation, l’ensauvagement du web », http://theconversation.com/lensauvagement-du-web95190?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton (Consulté le 21 janvier 2020)
[14] Idem
[15] Les réseaux sociaux remplissent aussi une fonction de régulation sociale. La parole étant souvent non libérée lorsqu’il y a une contrainte par la présence physique des acteurs en jeu.
[16] La possibilité offerte aux uns et aux autres de pouvoir s’inventer des multiples identités, par le biais des pseudonymes favorise les comportements agressifs. La croyance d’une certaine supériorité voire d’une impunité favorise ces comportements. V° l’effet de désinhibition en ligne, analysé dès 2004 par le psychologue John Suler, ce dernier distingue bien « l’anonymat dissociatif » qui fait que « le moi en ligne devient un moi compartimenté », la séparation de son action en ligne de sa vie réelle développant un sentiment d’impunité.
[17] Certaines plateformes peuvent offrir le sentiment d’appartenance à une communauté. Un tel sentiment accroit l’idée de toute puissance et de mépris pour les autres qui sont hors du cercle
[18] Il doit être mis en lien avec l’anonymat dissociatif. Le fait de ne pas voir l’interlocuteur libère le locuteur des freins sociaux et éthiques. Il peut alors développer son agressivité verbale envers autrui. Emmanuel Levinas « le visage est signification » dit-il dans Éthique et infini, (1984, Le Livre de Poche, « Coll. Biblio essais »), le visage d’autrui est moins vu qu’il n’est d’abord une vision, un regard qui nous voit.
[19] La haine est banalisée sur les réseaux sociaux. Le développement de la théorie du complot favorise cette ouverture plus grande aux messages haineux.
[20] Dans la mesure où, l’audience est mesurée sur l’internet, l’on assiste à une compétition du coup d’éclat qui favorise la levée des barrières sociales et éthiques. Au surplus, l’on note que ce sont les comportements transgressifs qui ont la plus grande audience sur le web.
[21] Cette culture qui s’est développée sur les réseaux sociaux favorise, sous le couvert de l’humour, de la dérision et d’un certain détachement la multiplication des « bons mots » pour déclencher un rire sans égards à certains excès.
[22] A. Mercier écrit à ce propos : « Les habitudes prises de publier des messages courts (quand ce n’est pas le dispositif qui l’impose) bannissent la subtilité du raisonnement au profit d’affirmations péremptoires et souvent offensives. Il peut en résulter aussi un relâchement lexical que la culture du texto et du mail ont introduit, gommant peu à peu les formules de politesse, les phrases rituelles d’entrée en interaction et de clôture, héritées de l’échange épistolaire, au profit d’un propos direct et épuré, allant droit à l’essentiel (logique d’efficacité face au flux des messages à gérer) mais rentrant aussi plus dans le vif du sujet, en considérant encombrant l’enrobage, superflu l’euphémisation, superfétatoire les marques de respect et de préservation de la face d’autrui », « Un processus de décivilisation, l’ensauvagement du web », http://theconversation.com/lensauvagement-du-web95190?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton (Consulté le 21 janvier 2020).
[23] J. A. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942, trad. Fr. 1951, rééd Payot, coll. « Bibliothèque historique », 1998.
[24] G. von der Weird, « Quelle justice sur les réseaux sociaux », Les cahiers de la justice, 2017/3, p. 524.
[25] Idem
[26] L. Lessig, Code and Other Law of Cyberspace, Basic Books, 1999, p. 198. Adde L. Lessig, « The Zones of Cyberspace », Stanford Law Review 1996, vol. 48, n° 5, p. 1403-1411.
[27] D. R. Johnson et D. G. Post, « Law and Borders : The Rise of Law in Cyberspace », Stanford Law Review 1996, vol. 48, n° 5, 1367-1412
[28] A. Degenne, « L’analyse des réseaux sociaux, bref panorama », Flux, Cahiers scientifiques internationaux, Réseaux et territoires, Année 1993, pp. 48-51, N. Zammar, Réseaux sociaux numériques : essai de catégorisation et cartographie des controverses, Thèse, Université Rennes 2, 2012, HAL Id: tel-00687906, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00687906 (Consulté le 24 janvier 2010).
[29] M. Weber, Le savant et le politique, Union Générale d’Éditions, 1963 ; M. Troper, « Le monopole de la contrainte légitime », Lignes, 1995/2, n° 25, p. 34 – 47.
[30] « Et cette virtualité peut inciter les auteurs d’écrits ou de propos susceptibles de porter atteinte à l’intérêt de tiers à penser qu’ils peuvent bénéficier d’une impunité, soit du fait de l’anonymat derrière lequel ils se réfugient parfois, soit tout simplement parce qu’ils pensent que ces publications ne tombent pas sous le coup de la loi », N. Verly, « Diffamations et injures publiques sur les réseaux sociaux : définitions, responsabilités et sanctions », AJ Collectivités Territoriales 2014 p. 589
[31] Article 4 de la loi n° 2017-7 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques (JORT n° 21 quarto du 7 juillet 2017, p. 16 et s). La même définition quasiment est retenue par l’article 1er de la loi nº 2004‐575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l’économie numérique » (dite aussi « LCEN »). Les communications électroniques ont été définies par la loi 2012-018 du 17 décembre 2018 sur les communications électroniques (JORT n° 56 du 17 décembre 2018, p. 2 et s.), comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ou optique »
[32] En droit français, il existe une approche de définition émanant de la circulaire du 17 février 1988 qui la définit comme « un message qui est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes déterminées ou individualisées », Circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 de la loi nº 86‐1067 du 30 septembre 1986 « relative à la liberté de communication, concernant le régime applicable à certains services de communication audiovisuelle ». Cette définition éclaire la notion sans référence au nombre de destinataires de ce courier.
[33] TGI Paris, 30 avr. 1997 et TGI Paris, 10 juill. 1997.
[34] Y. Mayaud, « De la mise en cause diffamatoire d’une gestion municipale : l’enjeu de la publicité », Rev. sc. crim., 1998, p. 104. V. également sur ce point (Ch. Debbasch, H. Isar et X. Agostinelli, Droit de la communication, 1re éd. Dalloz, « Précis », 2001, nº 1031. La caractérisation d’une communauté d’intérêt relève de la casuistique. Pour cibler une communauté d’intérêts, les juges procèdent par tâtonnements en usant de la technique du faisceau d’indices
[35] CA Paris, 9 mars 2011, nº 09/21478. Elle avait approuvé les juges de première instance qui, à propos d’un groupe restreint sur un réseau social, avaient considéré que « l’accès aux informations mises en ligne était limité à des membres choisis, en nombre très restreint, membres qui compte tenu du mode de sélection, par affinités amicales ou sociales, forment une communauté d’intérêts, exclusive de la notion de public ».
[36] V. Cass. crim., 22 janv. 2019, nº 18‐82.612, F‐P+B.
[37] Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, nº 11‐19.530, D. 2013. 1004 ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2014. 508, obs. E. Dreyer ; B. Bossu, Le salarié, le réseau social et l’injure, JCP E 2013. 1371.
[38] A. Casanova, « La distinction entre communication publique et privée peut-elle s’affranchir de la prise en compte du nombre de destinataire du message ? », RLDI n° 153, 1er novembre 2018, p. 4. V. les décisions des cours d’appels de Besançon, 15 novembre 2011, nº 10/02642, et de Rouen 15 novembre 2011, nº 11/01830.
[39] Cass. 1re civ., 10 avril 2013, nº 11‐19.530 précité.
[40] L. Saenko, « Nouvelles technologies et liberté d’expression : le droit penal (perdu) entre adaptation et innovation », Archives de politique criminelle 2018/1 (n° 40), p. 55-75. URL : https://www-cairn-info.ressources.univ-poitiers.fr/revue-archives-de-politiquecriminelle-2018-1-page-55.htm, (consulté le 20-01-2020) ; X. Auroy et E. Stella, « La liberté d’expression face aux réseaux sociaux », Dr. pénal 2017, n° 6, et. 13. A. Lepage, « La notion de communauté d’intérêts à l’épreuve des réseaux sociaux », CCE 2013, n° 7, p. 43 ; S. Defix, « Réseaux sociaux et règles de propagande électorale », AJCT 2014. 580.
[41] Article 290 code pénal togolais. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. Adde Article 291 : « La publication directe, ou par voie de reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois avec sursis et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ». V. aussi Loi française du 29 juill. 1881, art. 29, al. 1er.
Comparer avec le droit de la presse Article 169 de la loi n° 2020-001du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise, JORT n° 1 bis, 7 janvier 2020, p. 1 et s. : « Toute allégation ou imputation mensongère d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputation de diffamation, est punie d’une amende d’un million (1.000 000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la destruction des exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Il peut en outre ordonner la suspension de la publication ou de la société de presse audiovisuelle pour une durée d’un (1) à trois (3) mois.
En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa 2 du présent article est appliqué ».
[42] Notamment l’expression « par quelque procédé de communication que ce soit ».
[43] L’allégation suppose de reprocher un comportement précis ou un acte particulier à un individu. La forme de l’allégation importe peu. Elle peut être faite de manière interrogative, affirmative ou par insinuation.
[44] La jurisprudence est constante, pour une application récente, Crim. 16 sept. 2014, n° 13-85.061 ; Cass. crim., 16 mars 2004, nº 03-82828, Bull. crim., nº 67 – Cf. également : Cass. crim., 7 déc. 2010, nº 10-81984, Bull. crim., nº 197.
[45] Cass.crim., 26 janv. 2016, nº 14-87039, inédit : Dr.pén. mai 2016, comm. 80, obs. Conte.
[46] Tels que des faits d’empoisonnement, Crim. 8 avr. 2014, n° 12-88.412 ou de malversations.
[47] Crim. 19 déc. 2000, n° 00-82.585.
[48] Crim. 6 déc. 1988, n° 00-82.585, Bull. crim. n° 411.
[49] Article 297 du Code pénal. Comp. Art. 164 de la loi n° 2020-001du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise, JORT n° 1 bis, 7 janvier 2020, p. 1 et s. : « Toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait est une injure.
L’injure commise envers les personnes ou les corps désignés à l’article 161 est punie d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ».
[50] Article 300 du Code pénal.
[51] Loi n° 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, JORT n° 24 ter du 7 décembre 2018, p. 1 et s.
[52] Article 17 de la loi n° 2018-026 du 7 décembre 2018 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, « L’injure commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personne qui se distingue par une de ces caractéristiques, est punie de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ».
[53] Crim. 22 oct. 2013, n° 12-84.408, D. 2013. 2523.
[54] Crim. 10 mai 2006, n° 05-82.971, D. 2006. 2220, note E. Dreyer.
[55] V. l’article 290 du code pénal pour la diffamation et l’article 298 code pénal pour l’injure.
[56] En droit français, la diffamation et l’injure non publiques sont prévues et sanctionnées par des contraventions.
[57] Si les membres de ce cercle restreint sont tous liés par un même élément, qui peut être la relation professionnelle ou familiale, ils ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à l’auteur de l’injure et à la victime.
[58] L’exceptio veritatis est un fait justificatif. Il permet à l’auteur de la diffamation de prouver que ses allégations étaient vraies, justes et fondées. V. C. Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, 7ème éd., 2019, Gualino, n° 345.
[59] Article 368, alinéa 1er du code pénal.
[60] Article 369 du Code pénal. La sanction est d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à trente millions (30.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, que ce soit une personne physique ou morale qui viole l’intimité d’une autre personne.
[61] Article 466 du Code pénal : « Le chantage est le fait d’obtenir en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération : une signature ou la remise d’un écrit, d’un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge ; un engagement ou une renonciation ; la révélation ou la non-révélation d’un secret ; la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ; ou tout avantage indu ».
[62] Article 467 du Code pénal togolais. : « Toute personne coupable de chantage est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (3) an(s) et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ».
Article 468 du Code pénal : « La peine sera d’un (1) à cinq (5) an(s) d’emprisonnement :
si la menace a reçu un commencement d’exécution ;
si le coupable exerce habituellement une telle activité ;
s’il abuse, pour l’exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ou sa fonction ;
si le coupable exerce son activité délictueuse au détriment d’une personne particulièrement vulnérable, en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ;
si le coupable conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition à la ruine et/ou au suicide.
La peine sera de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion criminelle en cas de chantage assorti de violences physiques ou morales ».
[63] La mise en ligne du contenu peut être le fait d’un ex-partenaire en vue d’embarrasser ou de se venger de la victime. Elle peut également être le fait d’un pirate qui exigera une rançon pour supprimer le contenu.
[64] C. Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et droit pénal des affaires, op. cit., n° 139, p. 76 et s.
[65] Selon l’alinéa 2 de cet article, le maximum de la peine sera prononcé lorsque le harcèlement sexuel est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique ; par une personne ayant abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, sa position sociale ou professionnelle à l’égard de la victime.
[66] Le droit du travail togolais n’a pas légiféré sur le harcèlement moral, v. A. V. Eklu-Koevanu, Réflexions sur le harcèlement moral en milieu professionnel au Togo, Mémoire de DESS, Université de Lomé, 2008-2009.
[67] Une qualification unique aurait permis de poser une approche générique qui pourrait ouvrir la voie à des précisions. M. Benilouche, « Pour la création d’une qualification unique de harcèlement », Dr. pen. Sept 2015, étude 18. 132.
[68] J.-P. Bellon et B. Gardette, Harcèlement et cyberharcèlement à l’école : Une souffrance scolaire 2.0, Issy-les-Moulineaux, ESF, 2013, 151 p. (ISBN 978-2-7101-2600-3). Le cyberharcèlement peut se pratiquer par le biais des téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies
[69] Art. 9 code civil.
[70] Art. 9-1 code civil.
[71] En droit français, eu égard aux nécessités de l’information, les juges admettent que « la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve d’une part du respect de la dignité de la personne humaine » et d’autre part de l’existence d’un lien entre l’événement et les images publiées ou les révélations faites, Cass. 1re civ., 20 février 2001, JCP 2001, II, 10533, note J. Ravanas ; Cass. 1re civ., 10 mai 2005, Bull. civ. I, n° 206, p. 175 ; Ph. Malinvaud, Introduction à l’étude du droit, 18ème éd., Lexisnexis, n° 377, p. 343 et s. L’on assiste dans ce cas à une tension entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, deux droits fondamentaux à valeur normative équivalente sur fond de droit à l’information. L’arbitre de cette opposition reste le juge qui a pour boussole la protection de l’intérêt le plus légitime.
[72] Cedh 23 juillet 2009 n° 12268/03, Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c/ France.
[73] C. Strugala, « La protection de la personnalité à l’épreuve du numérique », RLDI n° 66, 2010, p. 49 et s.
[74] C. Renault-Brahinsky, Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006, p. 35.
[75] Une telle interdiction n’est pas applicable à la garde à vue, de l’arrestation et de la détention provisoire qui sont des mesures privatives de liberté avant toute décision de justice déclarant une personne coupable et lui appliquant une sanction pénale. V. L. C. Ambassa, « La théorie des preuves pénales », Revue Africaine des Sciences Juridiques, vol.7, n°, 2010, p. 45.
[76] Article 18, alinéa 2 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, révisée par la loi n° 2002-029 du 31 décembre 2002 et par la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019, « Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
[77] Au plan pénal, la protection de l’honneur, la réputation et la liberté du présumé innocent impose de déterminer les infractions subséquentes aux atteintes. Ces infractions peuvent être caractérisées à travers, la dénonciation calomnieuse (Article 363 du code pénal : « Constitue une dénonciation calomnieuse le fait de porter des accusations mensongères contre une personne déterminée auprès d’un officier de police administrative ou judiciaire, d’un fonctionnaire de justice ou d’une juridiction, les supérieurs hiérarchiques ou l’employeur de la personne dénoncée ou de toute autre autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ») ; la diffamation (Article 290 du Code pénal) ; les publications interdites (497 du Code pénal : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines ». Il faut envisager l’hypothèse où cette violation de la présomption d’innocence se fait par voie de presse. Dans ce cas, l’article 955 du code de la presse et de la communication trouverait à s’appliquer : « La diffusion ou la publication d’informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l’information ou les faits, est passible d’une peine d’amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1.000.000) de francs CFA, sans préjudice d’autres peines prévues par les dispositions législatives en vigueur »), les commentaires tendancieux définit les commentaires tendancieux comme le fait de « celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans des conditions telles qu’il influence même non intentionnellement l’opinion d’autrui pour ou contre l’une des parties » et la violation du secret professionnel (Article 357 du Code pénal : « Constitue une violation du secret professionnel, le fait pour une personne dépositaire d’information à caractère secret, soit par état ou par profession, soit en raison d’une mission ou d’une fonction temporaire, de les divulguer hors les cas où la loi en impose ou en autorise la révélation »).
[78] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13ème éd., PUF, 2020, « Quadrige », V° Ordre public.
[79] Fougère, Du délit de fausses nouvelles, thèse, Nancy, 1943. Il faut noter qu’en droit français, ce délit est réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
[80] Article 497 du Code pénal togolais : « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, sera punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’auteur des nouvelles fausses visées à l’alinéa précédent est puni d’une peine d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, la peine sera d’un (1) à trois (3) an(s) d’emprisonnement et d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA d’amende ».
Adde Article 955 du code de la presse et de la communication : La diffusion ou la publication d’informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l’information ou les faits, est passible d’une peine d’amende d’un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, sans préjudice d’autres peines prévues par les dispositions législatives en vigueur ».
[81] Cass. crim. 8 déc. 1854, Bull. crim. n° 338.
[82] Crim. 13 avr. 1999, n° 98-83.798, Bull. crim. n 78 ; Dr. pénal 1999. Comm. 115, obs. Véron.
[83] En droit comparé, des propos constituant une propagande politique, « fussent-ils mensongers, ne sont que l’expression d’une opinion et ne constituent pas une fausse nouvelle », Crim. 16 mars 1954, Bull. crim. n° 111. L’annonce d’un fait futur, une prédiction ou un pronostic sont également exclus du champ d’application de la répression des fausses nouvelles, dès lors que l’auteur des propos litigieux n’a pas annoncé ni laissé entendre qu’il fondait ces derniers sur des données actuelles ou déterminées, Crim. 28 juin 1860, DP 1860. 1. 293. Le récit d’un fait doit également être distingué de son interprétation. ‘interprétation, même erronée, de la portée d’une modification législative par un journal de défense professionnelle ne saurait être considérée comme une fausse nouvelle, TGI Paris, 8 avr. 1987, Juris-Data, n° 043789.
[84] A. Vitu, Droit pénal spécial, t. 1, 1981, Cujas, p. 1240, n 1572.
[85] La négligence ou l’imprudence ne sont pas réductibles à la mauvaise foi, Crim. 21 juill. 1953, préc. La seule négligence consistant à ne pas vérifier une information ne saurait constituer à elle seule la preuve de la mauvaise foi (Crim. 19 mars 1953, Bull. crim. n° 100. La mauvaise foi n’est pas retenue, dès lors qu’il résulte des circonstances de fait que le prévenu a pu croire exacts ou même vraisemblables les événements qu’il annonçait, T. corr. Lille, 7 févr. 1959, JCP 1959. IV. 131. 390.
[86] Art. 553 du code pénal.
[87] G. de Négrier, « Le moral des troupes », Revue des Deux Mondes, 5ème période, tome 25, 1905, p. 481 – 505.
[88] E. Guérin, « Du fondement des forces morales », Histoire & stratégie, 2020, https://www.penseemiliterre.fr/du-fondement-des-forces-morales_137_1013077.html (Consulté le 14 février 2020).
[89] N. Deffains et J.-B. Thierry, « Répertoire de droit pénal et de procédure pénale », Dalloz, n° 43.
[90] F. Jobard, « Les infractions à dépositaires de l’autorité publique sont-elles des actes politiques ? Essai de méthodologie critique », in M. Offerlé, L. Le Gall et F. Proulx, La politique sans en avoir l’air, Presses universitaires de Rennes, 2012, pp. 261-278, hal-00744213.
[91] Article 301 du Code pénal togolais.
[92] Article 302 du Code pénal togolais.
[93] Article 293 du Code pénal.
[94] Article 292 du Code pénal. Comp. Art 161 du code de la presse et de la communication : « La diffamation commise envers les cours et tribunaux, les forces armées et les forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3.000.000).
En cas de récidive, le double de la peine maximale prévue à l’alinéa précédent est appliqué ».
Article 162 : « Est punie de la peine prévue à l’article 161 du présent code, toute diffamation commise, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres des cultes, les dignitaires des ordres nationaux, les fonctionnaires, les dépositaires ou agents de l’autorité publique, les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, les jurés ou les témoins du fait de leur déposition ».
[95] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13ème éd., PUF, 2020, « Quadrige », v. outrage.
[96] Article 490, alinéa 1er du code pénal.
[97] Article 491 Code pénal.
[98] Article 492 : « La peine d’amende prévue à l’article précédent peut être portée au double si l’injure ou l’outrage a été proféré publiquement ou a fait l’objet d’une diffusion publique du fait de son auteur
Lorsque l’outrage au drapeau ou ç l’hymne est commis en réunion, la peine encourue est d’un an (01) à six (06) mois d’emprisonnement et l’amende de cinq cent (500000) à deux millions (2.000 000) de francs CFA ».
[99] Cl. Lelouch et L. Monsénégo, Le dictionnaire de ma vie, Editions Kero, 2016.
[100] A. Claeys et J.-S. Vialatte, Rapport d’office parlementaire sur « L’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau », Rapport n° 476 (2011-2012) http://www.senat.fr/rap/r11-476-1/r11-476-11.pdf , déposé le 13 mars 2012 (Consulté le 23 mars 2020).
[101] A. de Neve, « Vers un devenir post-humain ? » http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.automatesintelligents.com%2Fechanges%2F2005%2Fjuil%2Fdeneve.html (Consulté le 21 Janvier 2020).
[102] In Defence of Posthuman Dignity, Bioethics, vol. 19, n° 3, p. 202-214, Bostrom, Nick.(2005).



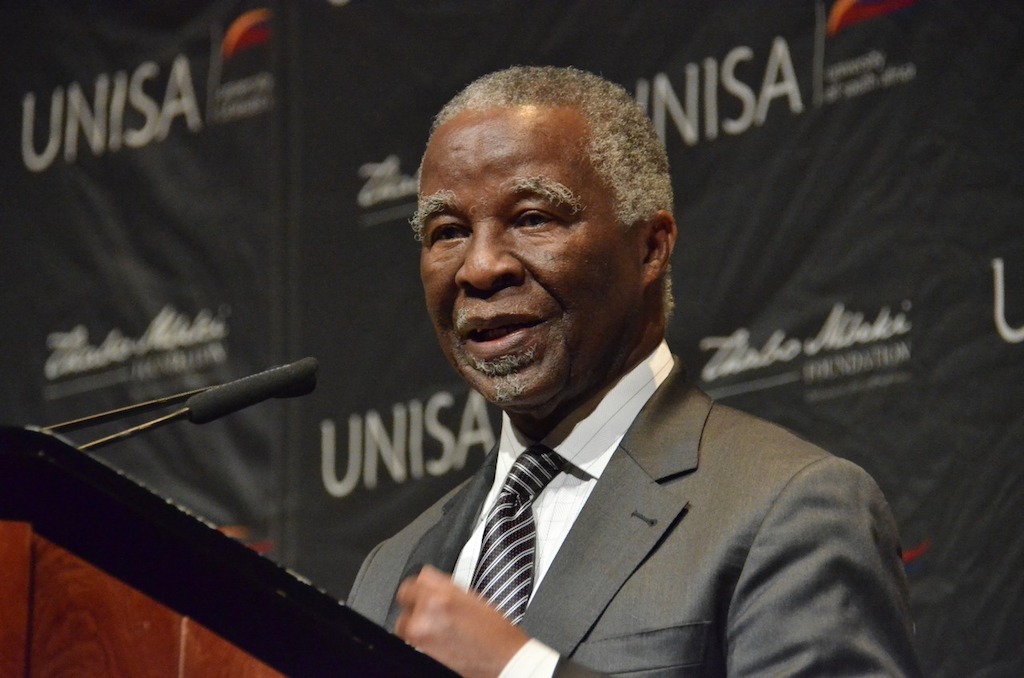

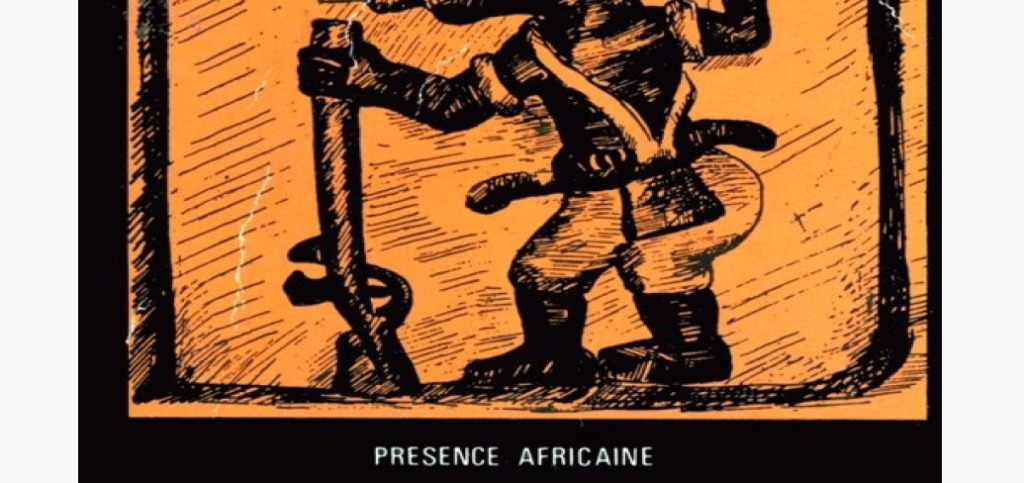
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.